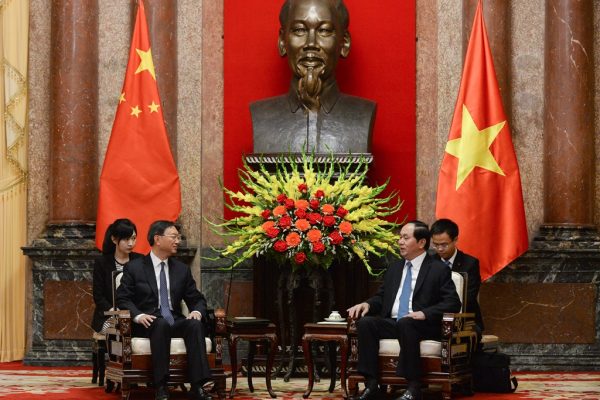Pirates asiatiques : les constantes d'une histoire discrète
Cependant, la plupart du temps, dans la plupart des lieux, la piraterie constitua un phénomène relativement mineur – l’action de gagne-petits aux moyens limités, à court rayon d’action. Par contre, on repère deux périodes de forte expansion. La première va du XIVe au XVIe siècle, et concerne surtout l’Asie du Nord-Est (Chine, Japon, Corée). Elle correspond au phénomène Wakô (« bandits japonais », mais le terme en vint à désigner un type d’activités illégales, contrebande en particulier, plus qu’un groupe humain spécifique), qui vit l’émergence de flottes pirates capables de concurrencer celles des pouvoirs publics. La seconde s’étend du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, et est centrée sur les mers archipélagiques d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Philippines, Malaisie actuelles), ainsi que sur la Chine du Sud. Centrée sur les rafles d’esclaves davantage que sur les attaques de navires, son pouvoir de nuisance sur le grand commerce fut néanmoins considérable. Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, les flottes pirates écumèrent les abords mêmes de Macao, de Singapour et (à partir de 1842) de Hong Kong. Si la puissance de feu et la rapidité des vaisseaux occidentaux les tinrent en respect (ceux-ci ne couraient un danger qu’en cas d’avarie grave, démâtage par exemple), le cabotage autochtone en fut fortement entravé, ce qui retentit sur la marche des affaires.
Deux hypothèses apparemment contradictoires peuvent expliquer ces variations dans le temps et l’espace. La plus courante relie les poussées pirates aux basses pressions étatiques. L’instabilité, les guerres, les crises renforceraient les propensions aux activités illégales et violentes, tout en suscitant un sentiment d’impunité. A l’inverse, on peut aussi remarquer que la soif de contrôle total des Etats forts génère diverses soupapes de sécurité, dont la contrebande et la piraterie – puisque le commerce légal est alors rendu très difficile, ou de peu de rapport. De même, dans l’ordre économique, si l’extrême pauvreté peut pousser aux comportements extrêmes (mais la piraterie nécessite une mise de fonds initiale…), l’appât du gain se renforce quand la richesse paraît à portée de main, et donc dans les périodes de prospérité. Ainsi, on constate une forte coïncidence entre l’apogée du « vent pirate » Iranun et Balangingi (archipel de Sulu, au sud des Philippines), au milieu du XIXe siècle, et la haute conjoncture représentée par la combinaison de la révolution industrielle européenne et du boom démographique chinois (qui touche alors à sa fin).
Par contre, le phénomène correspond à un moment de relatif affaiblissement de l’hégémonie européenne sur mer, lié au délicat passage de relais des Hollandais aux Britanniques, et au déclin final des principaux Etats autochtones de l’archipel indonésien. La grande piraterie chinoise, à peu près simultanée, peut être expliquée de semblable façon. Il en allait différemment de ses prédécesseurs Wakô. Ils apparurent et se développèrent principalement dans des moments favorables au commerce, mais ils avaient à faire côté chinois à un Etat fort, particulièrement au moment de la consolidation de la dynastie Ming (début du XVe siècle), qui leur porta de rudes coups. Les Wakô prospérèrent cependant : ils tiraient parti du besoin d’échanges extérieurs de beaucoup de Chinois, tout en profitant de la quasi-disparition de tout pouvoir central chez leur principal partenaire, le Japon, alors au paroxysme de ses guerres féodales, et cependant en pleine expansion économique. Cela leur fournissait sanctuaires et débouchés aisés. On avancera donc que la combinaison, dans une même région, entre Etat fort et Etat faible, le tout en conjoncture haute, est probablement idéale pour les pirates. Nos deux hypothèses (« hautes » ou « basses » pressions étatiques) n’étaient finalement pas si contradictoires.
Facilement amnistiés, voire promus par d’anciens adversaires
Le phénomène pirate déborde pourtant le clivage trivial entre pauvres et riches. Comme partout dans le monde, on trouve parmi les pirates beaucoup de marginaux en tous genres. Marginaux sociaux, comportementaux, mais aussi culturels. Ainsi le fondateur de la « dynastie » pirate Zheng, Zheng Zhilong, s’était-il converti au catholicisme sous le nom de Nicolas Iquan Gaspard, ce qui n’était pas trop commun dans la Chine du début du XVIIe siècle. Il eut avec une Japonaise d’Hirado un fils, qui devint le fameux Koxinga, conquérant de Taïwan aux dépens des Hollandais en 1662. Quant aux marchands ou pêcheurs, en période de difficultés, ils pouvaient se convertir occasionnellement en brigands des mers.
A la différence de l’Occident, il semble que la piraterie en Asie n’ait que rarement fait l’objet d’opprobre moral et de stigmatisation sociétale. Les textes européens eux-mêmes portent la trace de l’admiration dont pouvaient faire l’objet de grands écumeurs des mers, tel le « prince des pirates » La Ma’dukelleng (c. 1700-1765), devenu chef de l’Etat bugis de Wajo (île indonésienne de Sulawesi). Il n’était pas trop difficile pour un pirate d’être amnistié, voire promu par ses anciens adversaires. La piraterie chinoise est faite du va-et-vient de ses chefs entre le commerce légal ou le service public et la forbanterie. Ainsi, entre 1539 et 1552, le puissant marchand Wang Zhi avait mis sur pied avec les autorités un consortium commercial assorti d’une flotte de protection contre les pirates. Mais, dépité du maintien de l’interdiction du commerce extérieur, il passa de l’autre côté, et regroupa quelque 20 000 Wakô sous sa direction. Il contrôla un moment la côte de la province chinoise côtière du Zhejiang, et son réseau de forts/bases s’étendait en 1555 jusqu’aux abords du delta du Yangzi.
Le chef pirate opérait souvent au vu et au su de sa communauté d’origine, qui bénéficiait de ses prises – marchandises, travailleurs ou concubines. De jeunes princes, des guerriers prestigieux dans leur clan, des samouraïs des domaines du sud du Japon : tout cela faisait d’excellents pirates. Enfin, au XIXe siècle surtout, de riches commanditaires (négociants, mais plus encore sans doute petite et grande aristocraties locales) finançaient les raids, plus ou moins discrètement, escomptant de bons retours sur ces investissements à risque. Aujourd’hui, les complicités sont innombrables chez les fonctionnaires mal payés (douanes et gardes-côtes surtout), et les liens avec certains milieux d’affaires, en particulier dans le sud-est chinois, ont souvent été mis en évidence..
Ripostes étatiques tardives
Les ripostes appropriées à la piraterie se firent souvent attendre longtemps. Les Etats autochtones étaient pour la plupart cruellement dépourvus de forces navales, car peu d’entre eux eurent une politique d’expansion maritime durable. Ne firent exception que les sultanats d’Aceh (nord de Sumatra) et de Makassar (sud de Sulawesi), ainsi que, sur le seul océan Indien, et de manière intermittente, ces puissances lointaines qu’étaient le sultanat d’Oman et l’empire ottoman. Quant aux Occidentaux, ils étaient autant handicapés par leur médiocre connaissance, jusqu’en plein XIXe siècle, d’une géographie régionale particulièrement tourmentée, que par leur incapacité presque permanente à organiser des opérations conjointes. Le traité anglo-hollandais de 1824 (qui délimitait les empires coloniaux) prévoyait, premier en son genre, une lutte commune contre une piraterie alors plus audacieuse que jamais (article 5). Mais, là comme avant, les rivalités et les méfiances l’emportèrent. Les pirates continuèrent à se jouer des toutes théoriques frontières impériales. Dans le détroit de Malacca, il eût fallu que Londres et La Haye s’accordassent. Dans l’embouchure de la rivière des Perles, au sud de Canton, l’accord du Portugal et de la Chine étaient nécessaires à la mise en sécurité des approches de Hong Kong. Dans la région de Sulu, pire encore, Espagnols et Hollandais présentaient des revendications territoriales contradictoires. Enfin, les marchands asiatiques, rivaux, rechignèrent toujours à se regrouper en convois, plus aisés à défendre.
Soutenez-nous !
Asialyst est conçu par une équipe composée à 100 % de bénévoles et grâce à un réseau de contributeurs en Asie ou ailleurs, journalistes, experts, universitaires, consultants ou anciens diplomates... Notre seul but : partager la connaissance de l'Asie au plus large public.
Faire un don