Ce mercredi 27 juillet, en amont du sinistre premier anniversaire de la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, Amnesty International tire la sonnette d'alarme en publiant un rapport éprouvant sur l’oppression dramatique et systémique que les femmes et les filles afghanes subissent chaque jour.
« Ils ont fermé la porte à clé. Ils se sont mis à me hurler dessus [...] [Un membre des talibans] a dit : "Mauvaise femme [...] Les États-Unis ne nous donnent pas d’argent à cause de vous, bande de salopes" [...] Et puis il m’a donné un coup de pied. Le coup était si fort que j’ai eu une blessure au dos, et il m’a aussi mis un coup de pied dans le menton [...] Je sens encore la douleur dans ma bouche. J’ai mal dès que je veux parler. » Ce type de témoignage, d’une Afghane arrêtée après avoir manifesté pour les droits des femmes, incarcérée plusieurs jours et torturée pendant son emprisonnement, Amnesty International en a récolté une centaine.
Près d’un an après la prise de pouvoir du pays par les Talibans le 15 août 2021, l’ONG internationale alerte sur l’urgence d’agir en faveur du respect des conditions de vie des femmes Afghanes, en publiant un rapport approfondi intitulé « Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule » (Mort à petit feu : femmes et filles sous le régime taliban). Le constat est limpide : chaque détail du quotidien de ces femmes est contrôlé, maîtrisé et soumis à d’inquiétantes restrictions imposées par les lois draconiennes et le « système répressif » du régime taliban. « En moins d’un an, les Talibans ont décimé les droits des femmes », débute le rapport. L’enquête a été menée de septembre 2021 à juin 2022, et regroupe des entretiens réalisés auprès de 90 femmes et 11 jeunes filles, âgées de 14 à 74 ans, et habitantes de 20 des 34 provinces afghanes. Causette résume ce rapport en points clés.
Bannies de l'école
« Pour les femmes en Afghanistan, c’est la mort à petit feu », assure Adila, journaliste. Globalement, les règles imposées par les Talibans visent à exclure presque totalement les Afghanes de la vie publique, pour les enfermer chez elles. Les autorités continuent notamment d’éroder leur accès à l’éducation. Interdites de retourner étudier après la prise de Kaboul en août 2021, elles pensaient pouvoir retrouver les bancs de l’école le 23 mars 2022, quand les Talibans semblaient enclin à le permettre pour le niveau secondaire. Mais le jour même, alors qu’elles voyaient déjà leurs rêves d’émancipation possibles, les collégiennes et lycéennes ont finalement été renvoyées chez elles pour un « problème technique » lié à leurs uniformes.
Lire aussi : Afghanistan : les collèges et lycées pour filles referment quelques heures seulement après leur réouverture
« J’étais tellement impatiente de retourner à l’école, mais ils ne nous ont pas laissées entrer. Les Talibans nous ont dit que nous devrions attendre une prochaine annonce, et rentrer chez nous. Qu’est-ce que je peux faire de ma vie à l’intérieur de ma maison ? Si je ne peux pas devenir infirmière, docteur, artiste, ingénieure, qui vais-je devenir ? », se lamente auprès d'Amnesty Fawzia, 17 ans. Fatima, professeure de 25 ans au lycée témoigne du sentiment de découragement ressenti par ses élèves : « Ces jeunes filles voulaient juste avoir un futur, et maintenant, elles ne voient aucun futur devant elles. »
Le rapport révèle également qu’au niveau universitaire, les étudiantes doivent affronter le harcèlement des Talibans et faire face à de multiples restrictions sur leurs comportements, leurs vêtements et les opportunités qui leur sont offertes. Elles évoluent dans un climat si hasardeux et désavantageux que beaucoup de jeunes étudiantes ont décidé de ne plus se rendre à l’université ou de ne simplement pas s’inscrire, vu les perspectives de carrière si limitées. « Imaginez. Vous étudiez le journalisme en sachant que vous ne pourrez pas travailler en tant que journaliste. J’ai trouvé que c’était inutile d’étudier si je ne suis pas autorisée à faire ce que j’aime, donc j’ai quitté l’université », se résigne Metra, une étudiante de 21 ans en journalisme à Kaboul.

Empêchées de travailler et de se mouvoir
Les femmes qui sont la principale source de revenu de leur famille font face à d'innombrables obstacles dans le milieu du travail et se retrouvent souvent dans des situations désespérées. « Quand Nangarhar [province de l'Est de l'Afghanistan, ndlr] est tombée, mon bureau a fermé, car les hommes et les femmes ne sont pas autorisés à travailler ensemble. [Ma famille] a passé deux semaines sans nourriture. Avant, je n’aurais jamais imaginé que nous n’aurions pas de nourriture dans nos assiettes », se désole Farida, employée de bureau. Des employées du ministère afghan des Finances ont d’ailleurs raconté le 18 juillet avoir reçu des appels de responsables exigeant d'elles de laisser des hommes, et plus précisément les membres masculins de leurs familles, occuper leur propre poste. « Les femmes qui travaillaient en tant que professeures, journalistes, employées d’ONG, fonctionnaires… Elles sont chez elles, et se sentent comme si elles n'étaient plus rien… En plus de leur revenu, elles ont perdu leur dignité », s’indigne Huma, employée dans une ONG.
Lire aussi : Afghanistan : les talibans demandent aux femmes de trouver des hommes pour les remplacer au travail
Ces contraintes dans la sphère du travail s'ajoutent aux restrictions alarmantes sur les déplacements des Afghanes. Le pouvoir en place réprime de façon exponentielle leur liberté de mouvement. En décembre 2021, le Ministère de la Vice et de la Vertu a délivré une directive demandant aux femmes d’être obligatoirement accompagnées d’un mahram, un chaperon masculin, pour les trajets de plus de 72 km. : « Nous sommes en cage. Les Talibans ont fait de l’Afghanistan une prison pour toutes les femmes Afghanes », déclare Sorayah, étudiante de 16 ans.
Contraintes de couvrir leur visage en public
Pire, le 7 mai 2022, le Ministère a stipulé que les femmes devaient désormais couvrir leurs visages en public et ne quitter leur foyer qu’en cas de besoin. Les compagnies aériennes doivent également empêcher les femmes non-accompagnées d’un mahram de voyager seules, et elles ont été interdites d’obtention de permis de conduire. Pour beaucoup de femmes interrogées, le système même de mahram normalise et propage la misogynie dans tout le pays, puisqu'il creuse la différenciation entre les fils et les filles, pour qui les pères doivent sacrifier du temps pour servir de chaperon. « Tout ce que je vois, ce sont des murs autour de moi. Je ne peux même plus sortir de chez moi. Est-ce vraiment une vie ? », désespère Zohra, avocate.
Lire aussi : Afghanistan : les talibans imposent le voile intégral aux femmes
Le système d’aide face aux violences de genre anéanti
Le rapport d’Amnesty indique que l’arrivée des Talibans au pouvoir a provoqué l’effondrement du système associatif national mis à disposition des femmes victimes de violences de genre. Ce réseau comprenait la prise en charge médicale, juridique et psychologique des survivantes de violences, ainsi que l’accompagnement spécialisé et l'aide pour obtenir un logement d'urgence. Le régime en place s’est approprié ces logements, a harcelé et menacé les volontaires de ces réseaux, et a forcé de nombreuses victimes à retourner chez elles, à vivre dans la rue ou dans des conditions catastrophiques.
Les Talibans ont également libéré plus de 3000 détenus de prisons, pour la plupart inculpés pour des infractions de violences de genre. Zeenat a fui son mari et ses frères violents. Elle vivait dans un abri avec d’autres femmes victimes. Après la fermeture du logement associatif, elle a été contrainte de se cacher. « Nous sommes parties seulement avec les vêtements que nous portions. Mon frère est mon ennemi, mon mari est mon ennemi. S’il me voit, moi ou mes enfants, il nous tuera. Je suis sûre qu’ils me cherchent puisqu'ils savent que l’abri a fermé. »
Détentions arbitraires et tortures
À la moindre violation des politiques discriminatoires mises en place, les femmes sont arrêtées et détenues. Si elles sont aperçues en public sans mahram, si elles ne sont pas intégralement voilées, ou si elles sont attrapées en train de fuir un mari violent, les femmes peuvent être accusées du crime ambigüe de « corruption morale ». Selon Amnesty, une étudiante a été menacée, frappée et enfermée cette année après avoir été arrêtée sur la base de charges liées à l’absence de mahram. « [Les membres des talibans] ont commencé à m’administrer des décharges électriques [...] sur les épaules, le visage, le cou, partout où ils pouvaient [...] Ils me traitaient de prostituée [et] de garce [...] Celui qui tenait le pistolet a dit "Je vais te tuer et personne ne pourra retrouver ton corps" », décrit-elle. Pour la jeune femme, cette détention la stigmatisera à vie. « Pour une fille Afghane, aller en prison n’est rien de moins que mourir. Une fois que vous passez le pas de la porte, vous êtes étiquetée, et vous ne pouvez pas l’effacer. »
Lire aussi : Afghanistan : une vingtaine de femmes manifestent pour leurs droits
Les Afghanes n’ont plus de droit d’expression ou de liberté d’association. Les femmes tentent pourtant de combattre la répression induite par les Talibans en manifestant pacifiquement leur opposition. Une manifestante incarcérée pendant dix jours cette année dépeint son traitement en détention : « [Les gardiens talibans] n’arrêtaient pas de venir dans ma cellule pour me montrer des images de ma famille. Ils répétaient sans cesse [...] "Nous pouvons les tuer tous, et tu ne seras pas capable de faire quoi que ce soit [...] Ne pleure pas, ne fais pas de scène. Après avoir manifesté, tu aurais dû t’attendre à connaître des journées comme celle-ci". »
Détenues dans des conditions désastreuses et sans accès à l’eau ou à la nourriture, une dizaine de femmes retracent les violences physiques, verbales et psychologiques que les gardes des prisons leur ont fait subir, et les stratégies employées pour que leurs blessures ne soient pas visibles : « Ils nous ont frappées sur les seins et entre les jambes. Ils ont fait cela pour que nous ne puissions pas le montrer au monde. » Pour être libérées, elles doivent signer des déclarations pour garantir que ni elles ni les membres de leur famille ne manifesteront plus, ni ne s’exprimeront publiquement sur leur expérience en détention. Le 30 mai, le Ministre des Affaires étrangères Amir Khan Mutaqqi affirmait pourtant : « Dans les neuf derniers mois, aucune femme n’a été emprisonnée dans les prisons afghanes pour cause d’opposition politique ou de désaccord avec le gouvernement. »
Explosion des mariages forcés
L’enquête d’Amnesty, corroborée par les recherches d’organisations présentes en Afghanistan, montre que le nombre de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés a explosé sous le régime taliban. En cause : les crises économique et humanitaire qui continuent de se creuser, l’absence d’opportunité scolaire et professionnelle pour les jeunes filles, la volonté pour les familles de marier leurs filles à des Talibans ou de justement les protéger des Talibans en les mariant à d’autres hommes. « Quand les politiques des Talibans excluent les femmes et les filles de la société, induisent de l’incertitude et de la peur dans les communautés et empêchent les filles d’aller à l’école, les familles vulnérables voient le mariage forcé de leurs filles comme la seule option », explique Basir Mohammadi, directeur régional de l’ONG Too Young to Wed.
De nombreux témoignages de parents afghans ayant marié de force leurs filles invoquent en premier lieu les difficultés financières. Momin, un père de 35 ans originaire de la province de Badghis, raconte que, pour payer ses dettes aux autorités après avoir tenté de fuir le pays, il a été contraint d’arranger le mariage de sa fille Najla, 7 ans, à un homme du village voisin de 40 ans pour 120 000 Afghani (1 350$). « Qui veut faire cela à ses enfants ? Je n’avais pas d’autre choix… Je savais qu’elle allait souffrir. [...] La pauvreté vous fait faire des choses que vous n’avez jamais imaginé dans votre vie. Je ne suis pas le seul de mon quartier à avoir fait ça. Je connais dix personnes qui ont vendu leurs filles pour nourrir leurs autres enfants », s'afflige-t-il.
Un appel urgent à l’aide internationale
« Le monde n’entend pas et ne voit pas ce qu’il nous arrive, car ils ne sont pas affectés directement. Ils comprendraient seulement si ça leur arrivait aussi », s’attriste Jamila, directrice d’une école. Dans son rapport, Amnesty est catégorique : la communauté internationale doit montrer aux femmes et aux filles afghanes qu’elle entend leur détresse, pour agir au plus vite. Face à l’urgence de la situation, l’ONG appelle les États et les organisations internationales à envoyer un message clair et coordonné au régime taliban pour leur faire comprendre que leur politique actuelle envers les femmes est tout sauf acceptable.
Amnesty recommande de réfléchir à des leviers qui pourraient influencer le comportement des autorités sans nuire à la population afghane, avec des sanctions ciblées ou des interdictions de voyages. Selon l'organisation, les pays donateurs doivent riposter en priorité face aux crises humanitaire et économique, qui ravagent l'Afghanistan et ébranlent directement les droits des femmes et des filles. L'ONG préconise par exemple de renforcer les systèmes d’aide humanitaire et de soutien financier, avec la coordination des agences, des activistes, et des organisations présentes dans le pays. « Si la communauté internationale s’abstient d’agir, elle abandonnera les femmes et les filles d’Afghanistan, et fragilisera les droits partout ailleurs », signale Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.
Lire aussi : Afghanistan : pour la première fois, une vague de solidarité masculine envers les femmes






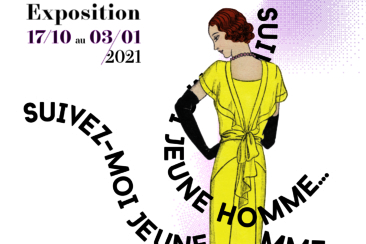
Cheap viagra https://forum.melanoma.org/user/canadianpharmacyonline/profile/
Valuable content. Many thanks.
Viagra 20mg https://www.buymeacoffee.com/pharmacies
Info nicely taken!!
canadian pharmacies shipping to usa https://www.brit.co/u/canadian-online-pharmaciesprescription-drugs
Really plenty of amazing information.
Buy viagra https://www.passivehousecanada.com/members/online-drugs-without-prescriptions-canada/
Great data. Many thanks !
Canadian viagra https://www.cakeresume.com/me/online-drugs-without-prescriptions-canada
You actually stated this adequately.
canadian pharmacy king https://rabbitroom.com/members/canadianpharmaceuticalsonlinewithnoprescription/profile/
Terrific facts, Kudos !
canadian pharcharmy online http://www.celtras.uniport.edu.ng/profile/canadianpharmacy/
Really lots of valuable data !
Viagra vs viagra https://amarutalent.edu.pe/forums/users/viagra-generic-canadian-pharmacy/
You stated it very well !
Viagra cost https://offcourse.co/users/profile/pharmacy-cheap-no-prescription
Regards. Lots of advice.
Viagra 20mg https://bitcoinblack.net/community/prescription-drugs-from-canada/info/
Wow a lot of very good facts.
canadian drug https://www.nzrelo.com/forums/users/canadianviagragenericpharmacy/
Nicely put, Cheers !
canadian rx https://www.beastsofwar.com/forums/users/canadiancialis/
Whoa lots of valuable tips !
northwest pharmacy canada https://www.windsurf.co.uk/forums/users/canadian-pharmacy-viagra-generic
You suggested it exceptionally well.
canadian pharmacy cialis http://www.mjyoung.net/weblog/forums/users/canada-online-pharmacies/
Perfectly voiced certainly ! !
Viagra prices https://solorider.com/forums/users/canadian-pharmaceuticals/
You actually said this wonderfully !
Discount viagra https://www.viki.com/users/canadianpharmaciess/about
You actually revealed this effectively !
canadian rx https://www.mixcloud.com/canadapharmacies/
You actually expressed this very well.
best canadian pharmacy http://climbingcoaches.co.uk/member-home/canadianpharmacies/profile/
Wow lots of terrific data.
Viagra generico online https://pinshape.com/users/2612491-medicine-online-order
Helpful tips. Kudos.
Online viagra https://500px.com/p/arrameru/?view=groups
Awesome posts. Regards.
Tadalafil 5mg https://www.provenexpert.com/canadian-drugs/
Kudos. Quite a lot of tips.
Viagra pills https://challonge.com/gyoupafefer
Lovely data. Many thanks.
How does viagra work https://keytygemi.estranky.cz/clanky/canadian-online-pharmacies.html
Kudos, Helpful information.
Viagra generico online https://wresitprelous.estranky.sk/clanky/canadian-drugs.html
Good forum posts. Cheers.
5 mg viagra coupon printable https://hafbeltminla.zombeek.cz/
Terrific data. Thank you.
canadian drugstore https://ecoutegli.bandcamp.com/track/pharmacies-shipping-to-usa
Many thanks. Numerous tips.
canadian pharmacies without an rx https://www.clubsandwiched.com/community/account/sagasdg/
Cheers, Terrific stuff.
Tadalafil 5mg https://pastelink.net/ii18z6qf
Thanks a lot, Wonderful stuff.
Viagra generika https://joshbond.co.uk/community/profile/shippingtousa/
Appreciate it ! Ample stuff !
Discount viagra https://shippingtousa.mystrikingly.com/
Many thanks ! Plenty of knowledge !
Buy viagra https://pharmaciesshipping.wordpress.com/2023/05/15/canadian-pharmaceuticals-online-with-no-prescription/
You revealed that wonderfully.
canadian pharmacies mail order http://trommelforum.ch/forum/profile/franbervage/
Thanks a lot, A lot of knowledge !
Viagra tablets australia https://www.horreur.club/community/profile/canadianpharmacy/
Regards ! Lots of tips.
Viagra daily https://essidi.cm/community/profile/canadianpharmacy/
Cheers, Terrific information.
Viagra tablets https://nicol.co.tz/community/profile/canadianpharmacy/
You actually revealed that really well.
canada pharmacy https://abusetalk.co.uk/forum/profile/canadianpharmacy/
Cheers. Numerous posts !
northwest pharmacies https://plclink.co.uk/community/profile/canadianpharmacy/
With thanks ! Loads of stuff !
Viagra generique https://warriorfarm.co.uk/community/profile/153413/
Well spoken really. .
Low cost viagra 20mg https://ascenddeals.com/beaverage/profile/canadianpharmacy/
Truly a lot of very good info !
canadian pharmacy https://baldstyled.com/community/profile/canadianpharmacy/
Thanks. Awesome stuff !
canada pharmacy https://www.careerstek.com/forum/profile/canadianpharmacy/
Many thanks ! Wonderful stuff.
canadian drugstore https://chanchuoi.com/community/profile/canadianpharmacy/
Perfectly expressed genuinely. .
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://sandikciyasar.com/component/k2/item/8?start=18640
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.kari-bra.de/admidio/adm_program/modules/guestbook/guestbook.php?headline=Gastebuch%5DApa
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
http://marcymonkman.com/mm_bizcard/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
http://drycut.com/blog/archives/3247/puffer
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://bloom-bloomshop.com/vacation-time
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://vtchemical.com.vn/index.php/san-pham/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://kroppefjalltrailrun.se/ktr18/img_3543/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.intellidb.co.uk/sql-server-instance-and-db-information-sql-2005/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.retezovakola.cz/?p=5
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://desertempireareana.com/what-is-the-narcotics-anonymous-program/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
http://北見尚之.nagoya/自己紹介/
Viagra vs viagra https://buyviagraonlinet.com/
Factor certainly utilized!!
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.criosimo.it/wp/elderly-care-and-support-volunteering/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
http://usexport.info/registraciya-kompanii-v-ssha/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://championrestoration.com/what-you-need-to-know-about-water-sources-water-damage/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.voyance-respectable.fr/christophe-medium-voyance-cartomancie/?cid=22752
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://www.ultimatepilatessystem.gr/egymosini-pilates-yoga/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
http://www.auto-secondhand.ro/cum-pot-fi-alese-corect-semineele/
« Pour elles, c’est la mort à petit feu » : la vie des Afghanes détruite par la répression des Talibans
https://porn85283.blogoxo.com/22360142/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-child-porn