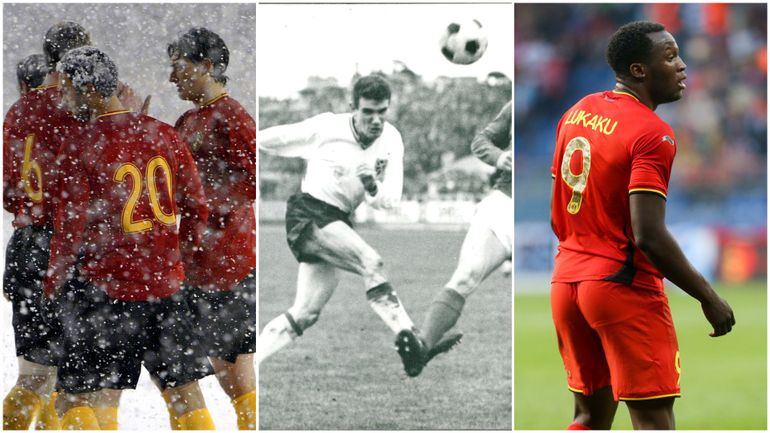Comme vous pouvez l’imaginer, je soutiens tout à fait cette décision, bien que l’idée que cette mesure n’échoue à cause d’erreurs fiscales me préoccupe. (J’y reviendrai dans un moment). Même si la banque a fait ce qu’il fallait, elle l’a fait, par contre, alors que des dissensions internes substantielles ont lieu. En fait, le nouveau plan de relance a été approuvé par seulement cinq des neuf dirigeants de la banque, et ceux qui sont les plus proches du monde des affaires ont voté contre. Ce qui m’amène au sujet de cette chronique : la sagesse économique, ou plutôt le manque de sagesse des dirigeants d’entreprises.
Certaines des personnes à qui j’ai parlé ici défendent l’idée que l’opposition d’un grand nombre de chef d’entreprises japonais aux actions de la Banque du Japon démontre qu’elle est sur la mauvaise voie. En disant cela, ils se font l’écho d’un sentiment commun à beaucoup de pays, y compris les Etats-Unis – qui veut que si l’on souhaite régler les soucis d’une économie à problèmes, l’on devrait se tourner vers les gens qui ont réussi dans les affaires, comme les dirigeants des grandes entreprises, des entrepreneurs ou des investisseurs aisés. Après tout, leur succès financier ne signifie-t-il pas qu’ils savent comment fonctionne réellement l’économie ?
Eh bien, en réalité, non. En fait, les chefs d’entreprises donnent souvent de très mauvais conseils économiques, notamment en périodes troublées. Et je crois qu’il est important de comprendre pourquoi.
A propos de ces mauvais conseils : pensons aux gestionnaires financiers immensément riches qui ont mis en garde Ben Bernanke contre le fait que les efforts de la Fed pour donner un coup de fouet à l’économie risquait de créer une "dévaluation de la monnaie" ; pensons à tous ces grands industriels qui ont déclaré solennellement que les déficits budgétaires étaient la plus grande menace qui pesait sur l’Amérique et que régler la dette allait entraîner la croissance vers une spirale ascendante. Au Japon, les chefs d’entreprises ont joué un rôle important dans les erreurs fiscales qui ont miné les succès politiques récents, appelant de leurs vœux une augmentation d’impôts qui a fait stagner la croissance plus tôt cette année, et une seconde augmentation d’impôts l’année prochaine qui serait une erreur encore pire.
De l’autre côté, les dernières années ont vu des justifications répétées venant d’hommes politiques qui n’ont jamais vu une fiche de paie mais qui en connaissent beaucoup sur la théorie économique et l’histoire. La réserve Fédérale et la Banque d’Angleterre ont navigué dans une crise économique qu’on ne voit qu’une fois toutes les trois générations, sous l’égide d’anciens professeurs d’université – Ben Bernanke, Janet Yellen et Mervyn King – qui ont eu, entre autres choses, le courage de défier tous ces grands magnats de l’industrie qui exigeaient que cesse l’impression d’argent.
La Banque Centrale Européenne a sauvé du désastre sous l’égide de Mario Draghi qui a passé la majeure partie de sa carrière dans les universités et le service public.
A l’évidence, il y a des chefs d’entreprises qui ont compris l’analyse économique et beaucoup d’autres qui se trompent. (Ne me lancez pas là-dessus). Mais avoir du succès dans l’entreprise ne semble pas impliquer une quelconque clairvoyance en politique économique. Pourquoi ?
Citant le titre d’un article que j’ai publié il y a de cela des années, la réponse tient au fait qu’un pays n’est pas une entreprise. La politique économique nationale, même dans les petits pays, doit prendre en compte des retours qui ne comptent presque jamais dans l’entreprise. Par exemple, même les plus grandes entreprises vendent seulement une petite fraction de ce qu’elles gagnent à leurs employés, alors que même dans des tous petits pays, ils vendent surtout des biens et de services à eux-mêmes.
Réfléchissons donc à ce qui se passe lorsqu’une personne du monde de l’entreprise qui a du succès regarde une économie troublée et décide d’appliquer les leçons de son expériences en entreprise. Il (ou rarement elle) voit les problèmes de l’économie comme ceux d’une entreprise, qui a besoin de réduire ses coûts et de devenir compétitive. Afin de créer de l’emploi, la personne du monde des affaires pense que les salaires doivent baisser, les dépenses doivent être réduites ; en général, on doit se serrer la ceinture. Et il est certain que des artifices comme le fait d’imprimer de l’argent ou des déficits budgétaires ne peuvent pas résoudre ce qui est un problème fondamental.
La réalité, cependant, c’est que toucher aux salaires et aux dépenses dans une économie déprimée ne fait qu’aggraver le véritable problème, qui est une demande inadaptée. Les dépenses déficitaires et une mise en service agressive de la planche à billets, a contrario, peuvent beaucoup aider.
Mais comment une logique de la sorte peut-elle être vendue aux chefs d’entreprises, notamment lorsqu’elle vient d’universitaires pompeux ? Le destin de l’économie mondiale pourrait bien dépendre de la réponse.
Ici au Japon, le combat contre la déflation est plus que bien parti pour échouer si les notions conventionnelles de prudence perdurent. Mais le non conformisme peut-il triompher des instincts des chefs d’entreprises ? La suite au prochain épisode.
Paul Krugman