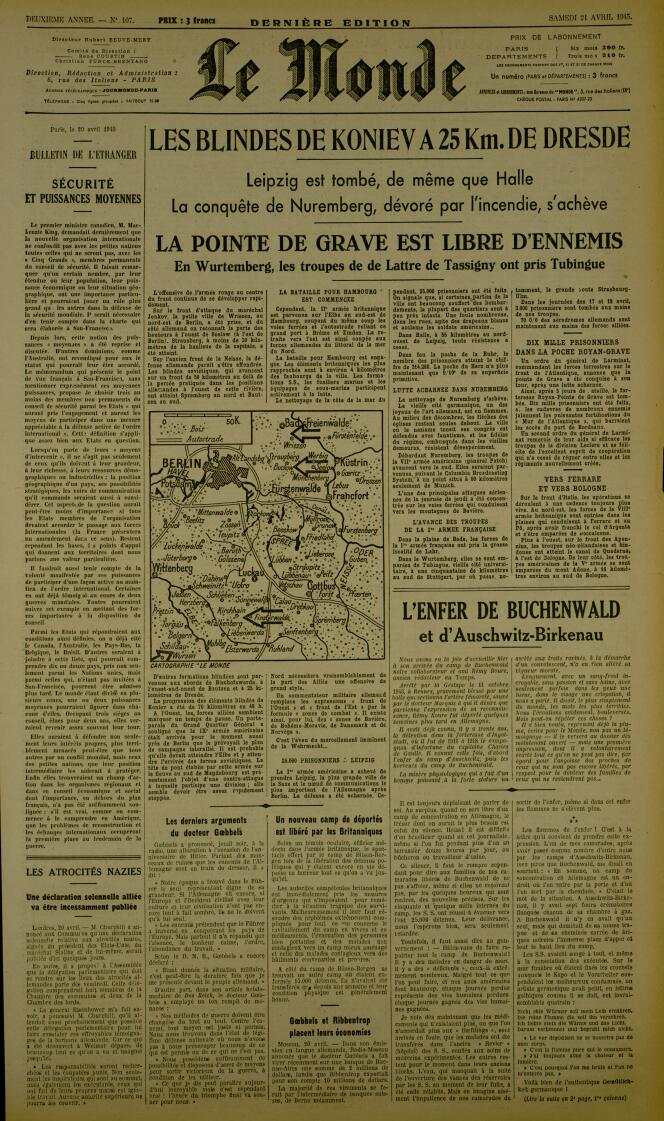
L’information tient en deux phrases. Deux phrases tassées en pied de page et noyées au milieu de six colonnes de brèves. « L’agence TASS annonce la libération par l’Armée rouge de quatre mille déportés politiques français, belges et hollandais, détenus par les Allemands dans le camp de concentration d’Oswiecim. Radio Moscou annonce, de son côté, que le gouvernement provisoire de la République polonaise a envoyé aux déportés libérés d’importantes quantités de vivres. »
Ce 8 février 1945, c’est sous la forme d’une simple brève que Le Monde apprend à ses lecteurs la « libération » d’Auschwitz par l’Armée rouge, intervenue une dizaine de jours plus tôt. Ce laconisme n’est pas propre au quotidien qu’a fondé Hubert Beuve-Méry quelques semaines auparavant. A part quelques lignes ici ou là, notamment dans Franc-Tireur et Fraternité, deux journaux issus de la Résistance, le silence est général. « Pas un mot, pas une ligne, même dans la presse communiste », pourtant bien disposée à relayer les informations diffusées par les Soviétiques, observe le journaliste Didier Epelbaum dans un livre paru en 2005 (Pas un mot, pas une ligne. Génocides et médias. 1944-1994, Stock). En France, sur le moment, la libération d’Auschwitz est un « non-événement médiatique », note l’historienne Annette Wieviorka. Spécialiste de l’histoire d’Auschwitz, Tal Bruttmann souligne qu’« en janvier, lorsque les Soviétiques arrivent, ils entrent dans un camp presque vide, avec 7 000 rescapés dans un ensemble prévu pour 250 000 personnes. Il n’y a aucune masse qui frappe, mais un vide qui ne donne pas encore place à l’Histoire. Le narratif est absent. »
Il vous reste 84.86% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.






