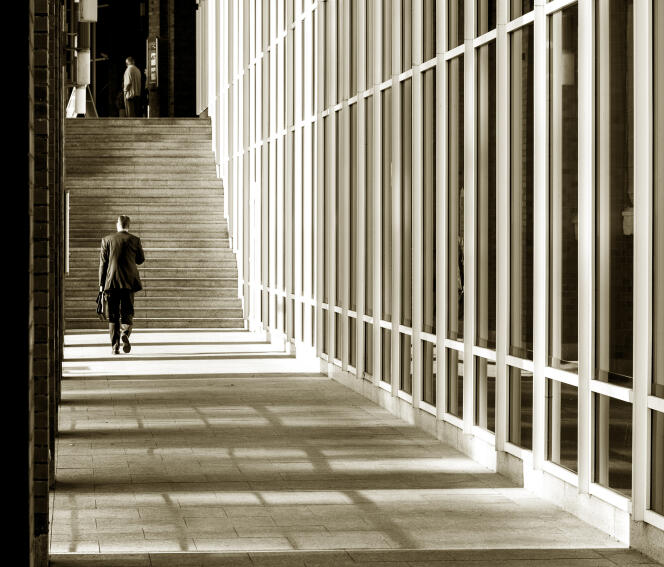
« Si je veux être provoc’ en soirée, voilà ce que je réponds lorsqu’on me demande ce que je fais dans la vie : “J’aide les entreprises à virer les gens”. Quand je souhaite être plus discret, je me présente comme conseiller en ressources humaines. Oui, j’exerce un drôle de métier, mais il est malheureusement devenu essentiel aujourd’hui. Les licenciements ont toujours existé. Il y en aura encore. Autant aider les entreprises à le faire correctement.
Je pense avoir viré plusieurs milliers de personnes depuis le début de ma carrière. J’essaie de ne pas trop y penser. Comment arrive-t-on à faire ce métier sans penser qu’on est un salaud ? Avec le temps, j’ai appris à me protéger. Et je me dis que je préfère que ce soit moi, car ce sera fait à peu près humainement. Mais ma hantise est de croiser une personne que j’ai fait partir. Ou, pire, de virer quelqu’un que j’ai déjà licencié.
Ce métier n’était pas un projet de vie. J’étais en DESS de droit du travail lorsqu’un gros plan a été annoncé dans une filiale de Schneider Electric – 100 départs sur 180 personnes – dont le DRH était l’un de mes professeurs. Il m’a demandé de l’aide pour accompagner les salariés pendant la phase de reclassement. Six mois plus tard, j’étais nommé DRH adjoint de la filiale. Lorsqu’un fonds franco-luxembourgeois a racheté la société et exigé un nouveau plan, mon premier réflexe a été de refuser. Trente personnes en moins, sur 80 salariés, c’était énorme. Et je connaissais les équipes… « Ce plan se fera, avec ou sans toi », m’a répondu mon directeur. Cela semble paradoxal, mais j’ai finalement accepté parce que j’aimais bien les gens.
« La première fois, j’avais 26 ans, et ça a été particulièrement traumatisant. J’annonçais aux collègues avec qui j’avais sympathisé la suppression de leur poste. Je n’en dormais plus. »
Cette première expérience de PSE [plan de sauvegarde de l’emploi], à 26 ans, fut particulièrement traumatisante. J’annonçais aux collègues avec qui j’avais sympathisé la suppression de leur poste. Je n’en dormais plus. Je me sentais coupable, responsable de ce qui arrivait. Avec le recul, je me rends compte que cela s’est passé dans de bonnes conditions. Ils avaient de bons profils, ils ont facilement retrouvé du travail. Peu de temps après, j’ai créé ma société de conseil. Mon principal client était le fonds franco-luxembourgeois, spécialisé dans le rachat de sociétés en difficulté. Pendant quatre ans, j’ai fait trois à quatre plans par an.
Les petites entreprises que j’ai accompagnées n’avaient souvent pas le choix. C’était le plan, ou la clé sous la porte. Deux fois, en 2009 et 2013, j’ai été séquestré pendant vingt-quatre heures. Des avocats m’avaient déjà conseillé d’avoir deux téléphones sur moi au cas où cela arriverait, mais en 2009, on n’a rien vu venir. C’était une entreprise de distribution, dans le nord de Paris. Trente personnes sur 98 devaient partir. La réunion s’est mal passée. Les syndicats nous ont retenus, le directeur général, le DRH et moi. C’était éprouvant. Personne ne savait comment ça allait se résoudre. On n’était pas à l’abri d’un gars qui rentre dans la pièce un peu éméché, ou d’un dogmatique qui nous prive d’eau.
Après cet épisode, je prévenais ma femme dès que le ton montait. “Ambiance tendue, je te textote toutes les trente minutes. Si pas de nouvelles, appelle la police.” La deuxième séquestration a eu lieu en 2013 dans une boîte pharmaceutique du Nord, mais, cette fois, un gars des RG [renseignements généraux] et un syndicaliste nous avaient prévenus. On a donc eu le temps de cacher dans les faux plafonds de la salle des négociations les médicaments du directeur général, un jeu de cartes, une tablette sur laquelle j’avais téléchargé un film. Dormir par terre, n’avoir qu’un seau en guise de toilettes, n’est pas très agréable, mais là, il n’y avait pas de violence. On a joué le jeu.
« L’opinion publique, les médias, les salariés ont intégré que le licenciement économique était devenu un outil de gestion d’entreprise. A tel point qu’on ne parle même plus des plans de moins de 100 personnes. »
Ces expériences font partie du job, c’est ce que j’explique aux dirigeants, qui ont souvent besoin d’être rassurés. Récemment, la DRH d’une entreprise pharmaceutique (250 départs) m’a appelé, paniquée : « Ils sont tous arrivés avec un badge avec leur prénom et leur nombre d’années d’ancienneté. » Rien de bien méchant. Les salariés ont besoin de témoigner leur attachement à l’entreprise, de rappeler qu’ils existent au moment où l’on joue avec leur avenir. Depuis que j’ai rejoint, il y a deux ans, un cabinet de conseil en réorganisation, j’ai de très grosses entreprises pour clients. Les plans sont à bien plus grande échelle – 600-700 personnes – mais je ne vois plus les gens. J’interviens en amont sur des fichiers Excel, des listes de postes. C’est plus mécanique, mais à titre personnel, c’est plus facile à gérer.
En dix ans, une certaine fatalité s’est installée en France. Pas une journée ne passe sans qu’un nouveau plan soit évoqué. Mais l’opinion publique, les médias, les salariés ont intégré que le licenciement économique était devenu un outil de gestion d’entreprise. A tel point qu’on ne parle même plus des plans de moins de 100 personnes. Areva annonce 3 500 départs… une journée de presse, point. Tous les PSE ne sont pas justifiés. Certains servent juste à améliorer les résultats de l’entreprise. On m’a proposé trois ou quatre missions de ce type. J’en ai refusé une. Pour les autres, j’ai exigé du client qu’il mette un maximum d’argent sur la table pour aider les personnes à retrouver un emploi.
A court terme, je suis assez inquiet pour l’avenir de la France. La durée avant le retour à l’emploi s’allonge. Les plans seniors se multiplient. Notre pays pâtit de nombreuses idées reçues. Entendre les investisseurs dire que la France est socialement plus compliquée que l’Allemagne ou la Grande-Bretagne me rend hystérique. Les rémunérations n’y sont pas forcément plus élevées. Les règles sociales sont différentes, mais pas forcément plus contraignantes. Il est dit qu’on travaille moins qu’ailleurs, c’est pourtant complètement faux. La France est un des pays où l’on travaille le plus au monde. »
Voir les contributions
Réutiliser ce contenu



