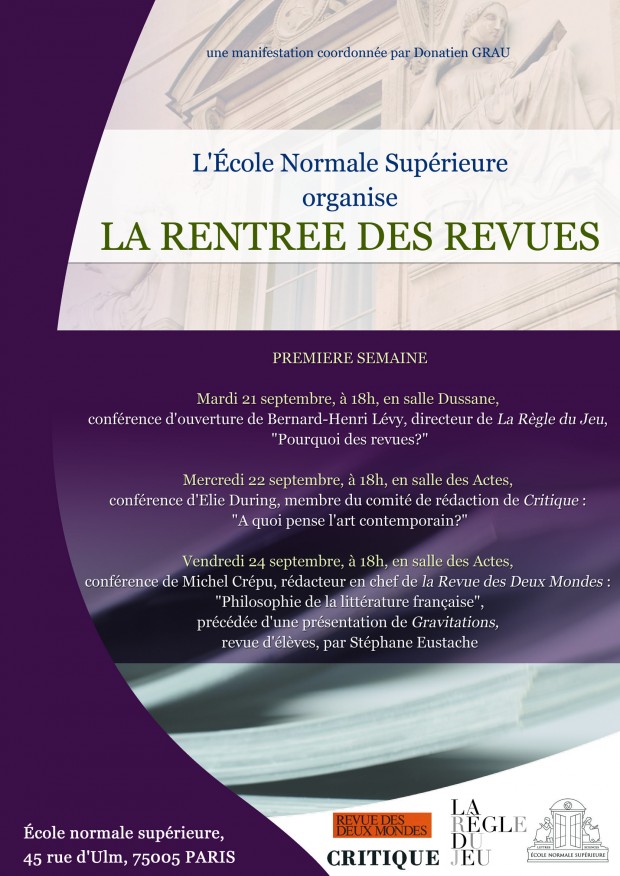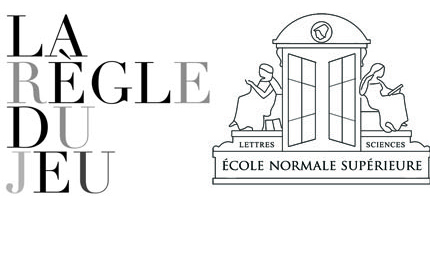En septembre 2016, près de 500 000 garçons et filles sont entrés dans l’enseignement supérieur (les trois quarts des 637 000 bacheliers 2016). On imagine aisément l’espoir qui les animait. Avoir 18, 19, 20 ans, la vie devant soi et quitter le lycée, avec ses contraintes et programmes uniformes, pour une voie d’études choisie en fonction de ses goûts et de ses talents ! Qui ne se souvient de l’exaltation ressentie dans les premiers jours de sa vie d’étudiant ?
Dans un pays développé qui aspire à une économie d’innovation, la capacité de former de nombreux diplômés de l’enseignement supérieur est un levier efficace pour la croissance économique future. Génération après génération, la qualité de la formation acquise après le baccalauréat est aussi le meilleur atout d’avenir pour la jeunesse, un capital indéfiniment réutilisable pour innover, s’adapter et réagir aux transformations du marché du travail. Ces deux raisons font que l’orientation massive des jeunes vers l’enseignement supérieur est fortement souhaitable. Celle-ci est facilitée en France par le fait que la plupart des filières de formation sont gratuites et non sélectives. Pourtant, le pourcentage de diplômés du supérieur n’est dans notre pays que de 40 % environ, les États-Unis faisant nettement mieux (plus de 60%) malgré leurs universités payantes et sélectives. Or un jeune sorti du système scolaire sans aucune qualification (ils sont environ 100 000 dans ce cas) ou avec le bac pour seul diplôme (environ 150 000) risque de rencontrer de grandes difficultés dans un marché du travail mû par l’innovation et le renouvellement des compétences. 2016, une rentrée réussie ! mais dont beaucoup de jeunes sont exclus !
Pour les bacheliers qui rejoignent l’enseignement supérieur, un privilège majeur est de pouvoir choisir leurs études. Dès le mois de janvier de l’année du baccalauréat, en effet, tous les élèves de classe terminale formulent leurs vœux d’orientation et se trouvent face à ce qui est, de façon inchangée depuis des décennies, l’essentiel de l’offre publique de formation supérieure, à savoir : 1) l’université ouverte à tous (environ deux tiers des étudiants), 2) les filières sélectives, surtout les classes préparatoires (environ 8 %), 3) l’enseignement supérieur technologique et technique (IUT et STS), lui aussi sélectif (un petit quart). L’éventail des options est nettement déséquilibré, mais sans doute estime-t-on qu’il répond aux besoins des plus doués comme des moins ambitieux car il perdure ainsi, malgré toutes les critiques. Par ailleurs, le fait que les étudiants ont un vrai choix de filières, puisqu’ils peuvent formuler jusqu’à 36 vœux, laisse le jeu réellement ouvert, dit-on.
Les lycéens qui ne connaissent pas grand-chose au « système » et vivent dans un milieu où l’on n’est guère informé des meilleures options de formation (en termes d’atouts, de programmes, de débouchés) choisissent souvent une orientation par défaut. Les bacheliers technologiques et professionnels sont principalement orientés vers les Instituts universitaires technologiques et les Sections de technicien supérieur. Ils peuvent choisir aussi d’aller à l’université, surtout quand ils n’ont pas été acceptés en IUT. Parmi les bacheliers généraux, certains tentent leur chance dans les filières sélectives, mais comme le taux de refus y est élevé (même parmi les candidats qui auront le bac avec mention B ou TB), ceux qui échouent à y entrer rejoignent souvent les universités. Ces dernières, pour lesquelles beaucoup d’étudiants optent en premier voeu, constituent également la dernière option d’orientation pour les nombreux bacheliers qui n’ont pas été admis ailleurs, ces derniers choisissant souvent les STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), la psychologie, la sociologie et l’anglais, où les candidats sont si nombreux qu’il faut parfois recourir au tirage au sort. S’ils ont peu de chances de réussir dans ces disciplines au vu de leurs acquis antérieurs, les signaux dissuasifs qui leur sont envoyés restent souvent sans effet, faute d’autre possibilité d’orientation.
En 2016, comme les années précédentes, tout le monde a trouvé sa place : 60 % des étudiants à l’université, 8 % dans les classes prépas, et 22 % dans l’enseignement technologique et technique. Attention ! Quelque chose cloche !! 50 + 8 + 22, cela fait 80 %. Où sont les 20 % qui manquent à l’appel ? Des missing students ? Eh bien oui, c’est la nouveauté des dernières rentrées, de plus en plus marquée chaque année. Une grande partie de ces étudiants manquants sont dans des « écoles » et « classes préparatoires » privées, parfois de bon niveau, le plus souvent médiocres, et toujours très coûteuses, qui se vantent d’offrir un bon environnement pédagogique et promettent d’excellents débouchés. À quoi s’ajoutent environ une dizaine de milliers d’étudiants inscrits dans des formations supérieures à l’étranger : études médicales, scientifiques, ou autres. Ces étudiants, souvent issus de milieux aisés, ont pu éviter le choix imposé à tous (filières sélectives ou non) ou bien n’ont pas été admis dans la filière qu’ils voulaient. En 2016, comme dans les années précédentes, le discours public est resté très discret sur ces chiffres, et nul n’y a officiellement reconnu un désaveu de l’offre de formation française ! Sur ce point aussi, 2016 était une rentrée réussie !
Jamais la démocratisation de l’enseignement supérieur n’a été plus manifeste. Le nombre global d’étudiants a été multiplié par 2,8 entre 1970 et aujourd’hui. Et il s’accroît chaque année : 32 000 étudiants de plus en 2016, en gros l’effectif de toute une université, 40 000 en 2015. Mais où vont au juste, ces étudiants ? À l’université, bien sûr ! C’est l’unique possibilité, puisque le nombre d’élèves dans les classes préparatoires et assimilées n’a presque pas bougé depuis dix ans, sélection et petit nombre de recrues renforçant leur prestige. Les universités, par vocation ouvertes, sont pour cette raison chaque année plus peuplées, et pourtant leurs locaux ne sont pas plus vastes, ou leurs enseignants plus nombreux. Rompus à faire face à des situations tendues, leurs responsables dédoublent les cursus, recrutent des vacataires, lancent des innovations pédagogiques. De plus, pour tenter de limiter le nombre de candidats, ils parlent de filières à effectifs réduits (à la limite de la légalité puisque la sélection en licence est interdite). Aucune de ces mesures toutefois n’a permis de dissuader les candidats qui n’ont aucune chance de réussir ou même, à l’opposé, à convaincre les bacheliers les plus brillants de s’orienter d’emblée vers ces filières universitaires plutôt que vers les classes préparatoires.
La démocratisation de l’accès aux études semble surtout avoir profité aux étudiants de milieux modestes. Mais encore faut-il qu’ils réussissent ces études ! C’est une certitude chez les étudiants des filières sélectives, qui obtiennent presque tous un diplôme après trois ans (et même des privilèges fort durables pour ceux recrutés dans les écoles les plus prestigieuses). Mais c’est un objet d’inquiétude pour les étudiants d’université dont 40 % seulement auront un diplôme dans les temps (parmi eux, on compte seulement 2 % des bacheliers professionnels et 7 % des bacheliers technologiques !). Or ces étudiants en échec, qui sortent sans diplôme ou mettent quatre ou cinq ans à avoir leur licence, sont presque tous issus de milieux modestes.
La démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur ne s’est donc pas accompagnée d’une démocratisation de la réussite, puisque seuls les élèves des filières sélectives, où les étudiants issus de milieux favorisés sont de loin les plus nombreux auront presque tous un diplôme. Elle ne s’est pas traduite non plus par une démocratisation de l’accès aux meilleurs débouchés car, à l’exception des filières de médecine et droit, les employeurs publics ou privés français sont encore réticents à recruter des étudiants formés par les universités, 20 % des titulaires d’une licence étant encore sans emploi deux ans après leur diplôme.
La rentrée 2016 a donc été comme les autres une rentrée enthousiasmante pour 30 % des étudiants (dans le meilleur des cas) et une rentrée opaque sinon irréelle pour beaucoup d’autres. À quoi sert de vanter la démocratisation de l’enseignement supérieur, et de se réjouir du fait que tant d’étudiants commencent des études supérieures, alors qu’on ne se soucie guère de ce qu’ils y font, de la manière dont ils sont formés et de ce qu’ils deviendront.
Pourtant, cette rentrée 2016 restera dans les mémoires car elle aura vu s’écrouler le tabou de la sélection à l’entrée en première année de master, après trois ans d’études donc. Ce qui semble annoncer des débats animés sur une éventuelle admission sélective à l’université. Les deux points sont en effet liés. Car si les étudiants reçus en licence, qui peuvent donc prétendre être admis en master (environ un tiers des étudiants) sont les mêmes qui auraient passé la barrière d’une sélection à l’entrée des universités, pourquoi différer une telle sélection, qui devra être mise en œuvre à un moment ou à un autre ? Cette question est légitime, mais elle en suscite une autre : que proposer aux 200 000 bacheliers environ qui auraient souhaité faire des études mais en auraient été écartés ? Les laisser rejoindre le nombre déjà élevé de ceux qui n’ont que le bac pour diplôme aurait pour conséquence qu’en France près de 70 % d’une classe d’âge seraient sans formation supérieure, même à vocation professionnelle, et que plusieurs centaines de milliers de jeunes auraient du mal à trouver leur place dans une économie d’innovation (n’oublions pas que le taux de chômage après un an des non-diplômés est de 50 %, et celui des seuls bacheliers, de 32 %). Si l’on veut donner à ces jeunes une formation supérieure d’un autre type, qui les prépare à un métier en leur donnant des ressources pour d’éventuelles reconversions, ce qui serait une voie de solution, en quoi consistera cette formation ? qui la donnera ? dans quel cadre ? Même si elle ne débouche pas nécessairement sur des diplômes universitaires, leur permettra-t-elle de combler leurs lacunes, de se préparer éventuellement à faire des études plus tard et surtout de jouer un rôle actif dans une société d’innovation ?
Le modèle institutionnel des universités paraît à bout de souffle, car il n’est pas à même, pour des raisons juridiques, culturelles et économiques, de garantir la réussite du nombre considérable d’étudiants qui s’y présentent chaque année, avec des niveaux et des types de formation préalables très hétérogènes. En conséquence, les amphis sont surchargés, les enseignants parfois inaccessibles, de nombreux étudiants se sentent abandonnés. De plus, les universités, tenues d’assurer leur place dans une compétition internationale de plus en plus en féroce, où la part de la recherche s’accroît, doivent également repenser leur modèle économique, entre les inconvénients liés à des frais d’inscription trop élevés qui entraînent un endettement colossal pour une génération entière, et une quasi-gratuité des études qui oblige l’État à assumer une lourde charge financière pour un résultat qui reste de toutes façons en deçà des standards internationaux.
Nos universités devront affronter aussi une mutation d’un autre type. Les modèles de formation supérieure sont de plus confrontés au défi majeur de préparer des étudiants qui seront professionnellement actifs dans une cinquantaine d’années, dans un monde largement inconnu de nous, où leur seul atout sera la solidité de leurs qualités intellectuelles et la capacité d’innover et de s’adapter. L’arrivée du numérique (cours en ligne, enseignement interactif, mutations dans les méthodes d’apprentissage) pourrait représenter un élément de la solution. On imagine volontiers que dans moins d’une dizaine d’années, les étudiants pourront prendre leurs cours en tout lieu et se former tout au long de la vie, comme dans un rêve d’université omniprésente et hors les murs. La pédagogie reposera en partie sur la communauté des apprenants et les enseignants seront présents de multiples façons, physiquement ou on-line. Ces moyens nouveaux amélioreront les choses, mais montreront aussi leurs limites, car ils ne sont que des moyens dont l’usage doit rester soumis à des finalités de formation claires et assumées.
Nous vivons sans doute les dernières décennies de l’université moderne, qu’elle soit de masse ou d’élite, et la fin des grandes écoles telles que nous les connaissons. Cette circonstance offre l’opportunité extraordinaire d’écrire une nouvelle page de l’histoire des universités françaises afin de les rendre capables de jouer un rôle économique, dans une société soumise à une obligation de renouvellement, et d’instiller chez la plupart de leurs étudiants l’enthousiasme pour les études choisies, et la confiance dans l’avenir liée à leur capacité d’y jouer un rôle actif, voire d’inventer de nouveaux modes d’activité, salariés ou non.
2016, une rentrée réussie ? Comme l’ont été les précédentes, mais selon une formule condamnée. Car en lieu et place de filières sélectives fermées qui ne donnent une garantie de formation solide qu’à un trop petit nombre d’étudiants, comme en une tragédie du petit nombre, en lieu et places d’universités encore trop à l’écart de la vie sociale, économique et culturelle, notre pays a besoin d’institutions encore à inventer, aptes à former une élite plus nombreuse, de créer la confiance en l’avenir et d’entraîner le renouvellement de la société. Des rentrées réussies comme celle de 2016, nous ne pourrons plus nous les permettre !