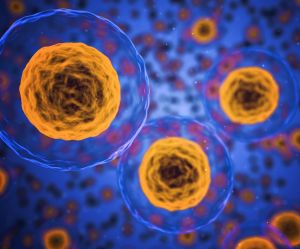Marlène Schiappa livre un décryptage glaçant de la culture du viol




Terrafemina : Qu'est-ce que la culture du viol ?
Marlène Schiappa : La culture du viol est un ensemble de mécanismes qui contribuent à minimiser les viols et les agressions sexuelles, à les excuser en trouvant des circonstances atténuantes aux violeurs, à ne pas les nommer. C'est aussi culpabiliser les victimes, les rendre responsables de ce qu'elles ont subies. Parce qu'elle excuse ces violences et les minimise, la culture du viol contribue parfois à rendre drôles ou à faire la promotion du viol et des agressions sexuelles. Tout cela contribue à instaurer un climat culturel qui tolère le viol, et fonde un consensus social tacite dans lequel on trouve qu'ils font partie de la fatalité, sont normaux ou excusables.
Le concept de la culture du viol, la rape culture, a été théorisé aux États-Unis, de nombreux ouvrages y ont été consacrés. À l'inverse en France, on a beaucoup de mal à prononcer le mot "viol". Pourquoi ?
M.S. : C'est le parangon du fait que la culture du viol est partout. J'ai mis trois ans à pouvoir sortir ce livre. Au début, j'avais écrit une simple tribune sur un site sur la question du viol et du fait qu'on ne nommait jamais les violeurs. J'ai été très étonnée de voir qu'elle avait été partagée des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. J'ai ensuite passé trois ans à frapper aux portes des maisons d'édition pour publier un essai sur cette question. Toutes celles que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas publier un tel ouvrage car le viol n'intéresse pas les gens, n'est pas feel good, est anxiogène. Finalement, j'ai eu de la chance de rencontrer les éditions de L'aube, qui ont accepté de publier mon essai.
Mais au moment de sa sortie, les représentants des libraires ont dit à l'éditeur qu'il fallait absolument changer le titre car les libraires n'oseront jamais parler d'un livre où il y a le mot "violeur" dans le titre. Les médias n'en parleront pas non plus parce que ça ne les intéressera pas. Avec le soutien de mon éditrice, j'ai tenu bon en expliquant qu'au contraire, refuser de dire ces mots faisait partie intégrante de la culture du viol. Dans mon livre, je reproche justement à la société de cacher les violeurs, ce n'est pas pour cacher cette réalité en modifiant mon titre.
Effectivement, il y a énormément d'ouvrages qui traitent de la rape culture aux États-Unis et au Canada, mais rien en France pour théoriser cette culture du viol et pour la démonter. Il y a une réticence générale à parler de cette question car elle met mal à l'aise, elle met face à des sujets qu'on n'a pas envie de regarder et d'étudier.
Pourquoi avoir décidé d'intituler votre essai Où sont les violeurs ?
M.S. : Pour moi, c'est le problème central de la culture du viol : on cache les violeurs. Dans les médias, on décrit toujours la victime et jamais le ou les violeurs. Dans l'immense majorité des cas, les articles nous expliquent que la victime l'avait un peu "cherché" : elle avait les cheveux détachés, elle était en train de courir, elle portait une minijupe, elle a souri, elle se promenait seule dans la rue... On trouve toujours le moyen de jeter le doute sur la victime. Par contre, on ne décrit jamais le violeur. Quand c'est le cas, on les décrit comme une "personne gentille", respectable, qui a juste eu un moment d'égarement ou un accident de parcours. On trouve systématiquement des métaphores pour ne pas écrire le mot "violeur". Cela a même conduit au mythe du "gentleman violeur". C'est encore pire quand les violeurs sont riches et/ou célèbres : on les excuse car ils ont "tellement de talent". Comme si le talent excusait d'agresser des femmes sexuellement. Il faut nommer ces hommes qui violent des femmes : ce sont des violeurs et il faut les condamner. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a si peu de condamnations pour viol en justice : on part du principe que ce n'est pas un violeur qui comparaît, mais un homme très sympathique et très aimable qui a eu un moment de faiblesse.
Il faut aussi nommer les violeurs pour ne pas les confondre avec tous les hommes. On dit souvent que les féministes détestent les hommes. Ce n'est pas du tout vrai, au contraire. Je pense que c'est beaucoup aimer et respecter les hommes que de dire que l'immense majorité d'entre eux n'ont jamais violé de femme et n'en violeront jamais. Mais qu'il y a des hommes qui violent des femmes et qu'il faut les nommer comme tels pour lever l'omerta.
Qui sont les violeurs ? Existe-t-il un profil type ?
M.S. : C'est très difficile de donner un profil-type au niveau national ou mondial car aucune étude n'a été réalisée sur cette question. En revanche, il y a une étude qui a été faite à l'échelle de Paris, forcément biaisée : elle n'a pas été accomplie à l'échelle de la France, mais surtout elle a été réalisée par une entité judiciaire. Elle se base donc sur les viols qui ont été dénoncés par des plaintes. Ce qu'on sait par cette étude, c'est que l'immense majorité des viols a lieu au domicile, qu'ils surviennent en janvier et septembre et que les victimes ne portaient donc a priori pas de mini robe. On apprend aussi qu'un certain nombre de marqueurs sociaux sont communs aux violeurs à Paris : ce sont souvent des hommes, de tous âges et souvent de nationalité étrangère. Mais encore une fois il y a un biais : on va plus facilement porter plainte contre un inconnu qui nous a violées que contre son patron ou quelqu'un de sa famille.
La culture du viol n'épargne donc aucun milieu socio-économique ou culturel ?
M.S. : Absolument. Il a d'ailleurs des viols absolument partout : dans les églises, les écoles coraniques, les camps laïques, les écoles, les camps militaires, les prisons, les hôpitaux, à l'extérieur, chez soi... Il y en a absolument partout et les victimes sont de tous âges. Les petites filles et petits garçons, comme les femmes de soixante-quinze ans sont susceptibles d'être violés.

Qu'est-ce que le victim blaming ? En quoi cela participe à la culture du viol ?
M.S. : Le victim blaming fait partie intégrante de la culture du viol. Ce terme américain désigne la honte que l'on fait porter aux victimes et la honte que les victimes ressentent d'avoir été violées ou agressées sexuellement. Elles ne vont pas en parler, ne pas dénoncer leur agresseur et encore moins porter plainte. Ça arrange énormément les agresseurs sexuels et les violeurs que les victimes aient honte. D'ailleurs, ils s'arrangent pour leur faire comprendre qu'elles doivent se sentir sales et avoir honte de ce qui s'est passé. Le victim blaming, c'est ça : c'est rendre responsables de ce qu'elles ont subies les victimes de viol. Cela passe par différents moyens : on peut les accuser de ne pas avoir suffisamment protesté, de ne pas avoir suffisamment dit non. Le victim blaming est par exemple présent dans l'affaire Denis Baupin. Après que l'affaire a été classée sans suite, Denis Baupin n'a même pas la décence d'en rester là. Désormais, il accuse les femmes qui sont victimes.
On l'a aussi vu dans l'affaire Flavie Flament, qui raconte dans son livre (La consolation, ndlr) avoir été violée quand elle avait treize ans par un photographe de renommée internationale. Plein de gens et de médias l'ont accusée de mettre en cause ce brillant photographe. Même son frère et sa mère ont parlé dans la presse pour discréditer ses propos, comme si elle portait la responsabilité d'avoir été violée quand elle était enfant. Cette inversion des valeurs est récurrente. On la voit notamment sur la question de l'alcool. En Allemagne, une campagne de pub a été affichée sur les campus pour dire aux jeunes étudiantes : "Ne buvez pas d'alcool ou vous risquez d'être violée". Cela sous-entend que ce sera de la faute de celles qui seront effectivement violées. Or, on ne dit jamais aux hommes : "Ne buvez pas d'alcool ou vous risquez de violer une femme". Il y a une responsabilité permanente qui est mise sur les victimes de viol, et uniquement sur elles.
Cette question de la culpabilisation de la victime est aussi présente dans l'affaire Brock Turner, que vous évoquez dans l'ouvrage.
M.S. : L'affaire Brock Turner (un étudiant de l'université américaine de Stanford avait été condamné à six mois de prison pour viol sur le campus, ndlr) illustre parfaitement le victim blaming, on dirait presque un cas d'école. Tous les articles de presse parus sur cette histoire ne titraient pas "violeur", mais parlaient de Brock Turner comme d'un "champion de natation", d'un "athlète" et d'une "star de l'université". Que son père et certains de ses professeurs soient venus au tribunal pour expliquer sans vergogne que le viol qu'il a commis allait ruiner sa vie, cela participe à la culture du viol.
Pour éclaircir l'affaire Brock Turner, il y a deux statistiques intéressantes. La première est que 71% des viols seraient prémédités. Cela veut dire que vouloir imputer le viol à l'alcool ou à une pulsion ne tient pas car dans la majorité des cas, il y a un moment où l'agresseur se dit "Je vais violer cette personne" et s'organise pour pouvoir mettre son plan à exécution. L'autre statistique intéressante nous vient d'Amnesty International : 90% des violeurs ne souffrent d'aucune pathologie mentale. Dans l'inconscient collectif, un violeur est un psychopathe, un serial killer. En réalité, c'est monsieur-tout-le-monde, qui décide en pleine conscience de violer une femme.
Quel regard portez-vous sur le traitement médiatique de l'affaire Théo ?
M.S. : Les médias ont eu énormément de mal à parler de "viol" dans ce cas, et pour deux raisons : d'abord parce que Théo a été violé avec un objet. Cela montre qu'il y a une vraie méconnaissance de ce qu'est un viol. Un viol est une pénétration non-consentie, qui peut aussi être faite avec des doigts ou avec un objet. Il ne faut pas oublie que souvent, le viol n'a pas seulement un caractère sexuel : il a aussi un caractère de domination sociale. On le voit notamment dans le viol de guerre. Quand des forces de police violent un jeune homme, ce sont ces mêmes mécanismes : il s'agit surtout de montrer qu'on le domine socialement et qu'on veut l'avilir, le soumettre sans qu'à aucun moment il n'y ait de connotation de désir sexuel.
Ensuite, le fait que la victime soit un jeune homme pose la question très taboue du viol des hommes. Je suis frappée qu'en France, aucune grande structure subventionnée ne s'attelle à cette question des hommes victimes de viol. On ne peut pas les laisser de côté qu'ils sont une minorité, d'autant qu'on sait que l'on sait que des hommes ayant été agressés ou violés peuvent reproduire ce schéma. Il est nécessaire de le casser grâce à une prise en charge.
Suite à une forte mobilisation sur Internet, Roman Polanski a finalement renoncé à présider la cérémonie des César. Constatez-vous une prise de conscience de l'opinion publique sur l'impunité dont jouissent certains agresseurs ?
M.S. : De l'opinion publique, je ne sais pas. Ce que je constate et déplore, c'est qu'on a totalement délégué aux associations et aux militantes féministes la prise en charge de ces questions. Comment est-ce possible qu'en 2017 quelqu'un accusé de viol sur mineur se voit confier la présidence des César et que personne ne proteste hormis les féministes ? Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont organisé bénévolement et sur leur temps libre la mobilisation. C'est finalement grâce à elles que Roman Polanski a renoncé à présider les César. Sans leur mobilisation, il n'aurait pas été inquiété.
Dans Où sont les violeurs ?, vous évoquez le coût économique et social du viol. De quoi s'agit-il ?
M.S. : C'est un coût qui n'est jamais étudié, du moins en France. Le coût du viol ne s'arrête pas au moment du viol. Il y a par exemple un impact médical, dénoncé notamment par le Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) : les femmes qui ont été agressées ne vont pas aller faire certains examens comme une mammographie, ou faire des soins dentaires ... Il ne faut pas oublier qu'un viol implique des séquelles qui a un impact sur la santé des femmes. Or, ce n'est jamais calculé ni dénoncé.
Il y a aussi un impact sur la trajectoire professionnelle des femmes. On les enjoint tout le temps à être sûres d'elles, à oser demander une augmentation. Mais c'est très difficile quand, lorsqu'elles marchent dans la rue, elles doivent faire tout le contraire, se dissimuler pour éviter d'attirer l'attention et d'être agressée. Ou bien quand elles subissent des agressions sexuelles chez elles. C'est complètement schizophrène.
Comment lutter aujourd'hui contre la culture du viol ?
M.S. : Je pense qu'il faudrait lancer une campagne d'ampleur nationale qui touche tous les lieux de sociabilité : les écoles, les universités, les lieux de travail. La lutte contre les violences sexuelles doit devenir une priorité comme l'est par exemple la sécurité routière. Il est tout à fait possible de sensibiliser au moyen de spots, et doter les associations de plus de moyens de prévention et de répression. Il faut aussi allonger les délais de prescription, mieux accompagner les victimes de viol en formant davantage les professionnels, mais aussi faire en sorte que les peines prononcées contre les violeurs et les agresseurs sexuels soient exemplaires.
Marlène Schiappa, Où sont les violeurs ? Essai sur la culture du viol, Éd. de l'aube.