
Lors des cérémonies organisées à Paris, le 11 novembre dernier, pour commémorer l'armistice de 1918, plusieurs chefs d'État, à commencer par Emmanuel Macron, ont dénoncé la monté des populismes.
© LUDOVIC MARIN / POOL / AFPTemps de lecture : 20 min
-
Ajouter à mes favoris
L'article a été ajouté à vos favoris
- Google News
Depuis la publication de son ambitieuse Nouvelle histoire des idées politiques, en 1987, Pascal Ory s'est fait une spécialité de l'étude de l'histoire de l'opinion en France, comme dans le monde. Hier enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à Sciences Po Paris, aujourd'hui professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), l'historien a publié, il y a quelques mois, un essai* dans lequel il cherche à comprendre les causes de la flambée populiste actuelle. Pour Le Point, il revient sur ce phénomène, à six mois des élections européennes. Entretien.
Le Point : Le populisme triomphe à travers le monde... De l'Inde de Narendra Modi au Brésil de Jair Bolsonaro, en passant par les Philippines de Rodrigo Duterte, la Hongrie de Viktor Orbán ou encore l'Italie de Matteo Salvini, les mouvements politiques ouvertement populistes font florès. Ce phénomène a-t-il un précédent historique ?
L'historien, Pascal Ory, a reçu le grand prix Gobert de l'Académie françaie pour l'ensemble de son oeuvre.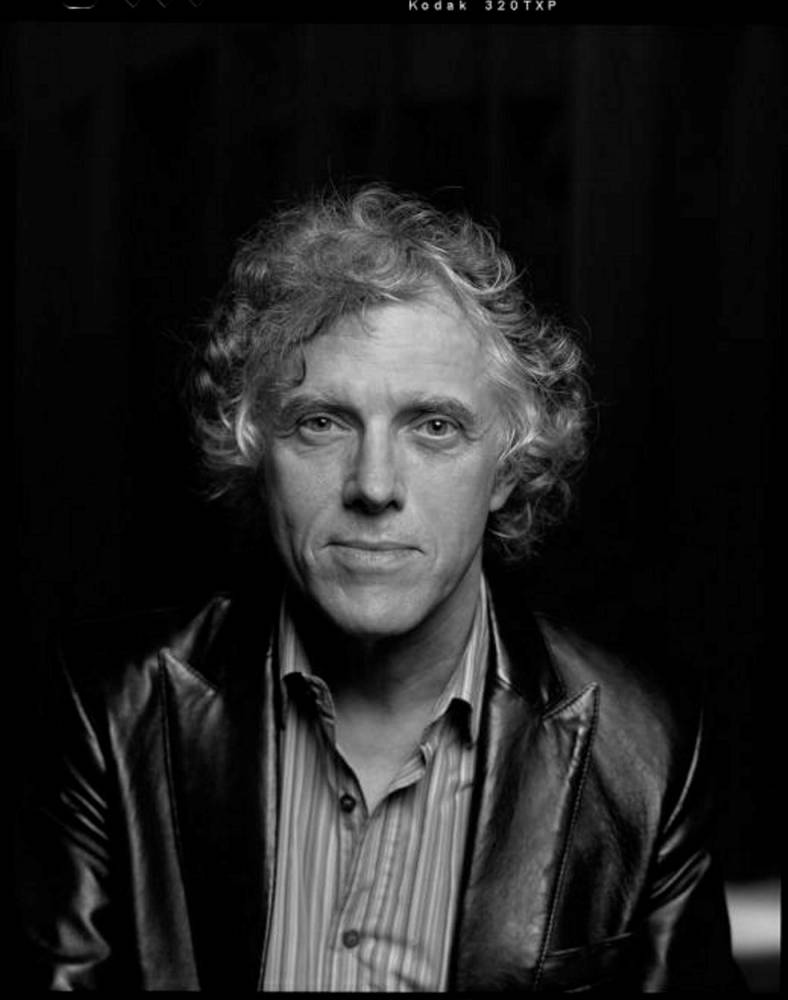 © DR">
© DR">
Lire aussi Luc de Barochez - Derrière le Brésil, l'Amérique latine passe à droite
Plus près de nous, la fin du XIXe siècle voit proliférer les leaders populistes en Russie, aux États-Unis et aussi en France...
Le populisme au sens moderne s'esquisse dans un pays comme la France à travers l'innovation que fut en son temps l'aventure bonapartiste. Après la Révolution française, dont il importe de rappeler qu'elle ne fut chronologiquement que la quatrième grande expérience révolutionnaire de la modernité – après les Provinces-Unies, l'Angleterre et les États-Unis –, mais qui fut aussi la plus radicale et la plus fragile, le bonapartisme incarne une forme inédite de démocratie autoritaire. Napoléon Ier puis son neveu seront empereurs non « de France », mais « des Français », et aimeront à ressourcer leur légitimité dans le référendum, dit « plébiscite ». Certes, Napoléon III accapare le pouvoir de manière illégale par le coup d'État du 2 décembre 1851, mais il en profite aussi – on ne le dit guère – pour rétablir le suffrage universel, écorné, dans les années précédentes, par les conservateurs, qui avaient entrepris d'épurer le corps électoral. Ce tour de passe-passe dit beaucoup : désormais, le suffrage universel tend à s'imposer comme base des nouvelles institutions politiques. Cet horizon suscite à gauche des formulations idéologiques nouvelles : du côté des intellectuels, comme en Russie (les « narodniki » des années 1880), du côté des tiers-partis, vieux rêve américain, toujours déçu (le People's Party des années 1890, qui lance le mot populist en anglais), et en France le mouvement boulangiste, qui est bel et bien le premier vrai parti populiste moderne, au sens où on peut l'entendre aujourd'hui.
Vous préférez faire le parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde, et cet épisode boulangiste. Plutôt que de convoquer les années 1930, comme l'a fait, encore récemment, Emmanuel Macron ?
Oui, encore que notre époque emprunte aussi aux années de l'entre-deux-guerres, mais j'y reviendrai. Le mouvement politique auquel Georges Boulanger a donné son nom – choix personnalisé significatif, comme pour « bonapartisme », qui apparaît dès la chute du premier Napoléon – me semble très intéressant en ce qu'il coalise autour de lui des personnalités venues d'univers politiques apparemment opposés. Le général Boulanger est un officier supérieur républicain, dont la carrière a été soutenue par la gauche. Sur la formule simple mais efficace d'un « Appel au peuple » et d'un discours antiparlementaire qui se nourrit de l'instabilité gouvernementale et des scandales réels ou supposés de la jeune République, il va faire tenir ensemble à la fois des monarchistes populaires, convaincus qu'un peuple sain balaiera les bourgeois voltairiens, d'anciens bonapartistes qui n'ont pas de mal à se retrouver en lui et, surtout, une part non négligeable d'anciens communards, principalement des blanquistes, réunis dans un « Comité central socialiste révolutionnaire », et, parmi eux, rien de moins que l'exécuteur testamentaire de Blanqui, Ernest Granger. Le blanquisme, ne l'oublions pas, est le chaînon manquant qui unit les derniers jacobins à Lénine. Au congrès de Tours, en 1920, qui voit en France la naissance du Parti communiste, Léon Blum identifiera clairement la filiation.
À ce sujet, v ous rappelez souvent que Benito Mussolini a commencé son parcours politique à l'extrême gauche avant de fonder le mouvement fasciste. Est-ce à dire que le populisme naît d'abord de ce côté-là de l'échiquier politique ?
J'ai toujours fait un distinguo entre gauche radicale et populisme. Pour moi, le populisme est une droite radicale dans un style de gauche radicale. Ses valeurs sont clairement celles de la tradition de droite : vitalisme, inégalitarisme, autorité, à quoi il ajoute la captation d'une grande valeur venue de la gauche (eh oui...), à savoir la nation, qu'il retourne comme un gant : on passe de la « Grande Nation » façon 1792, ouverte et libératrice, au « nationalisme » (le mot est popularisé positivement par un intellectuel boulangiste, qui n'est autre que Maurice Barrès), fondé sur la fermeture xénophobe et, en interne, sur le clivage entre « bons » et « mauvais » ressortissants de la nation considérée. Le populisme est même une extrême droite, par la violence de ses attaques contre les institutions établies, et, au premier chef, les institutions parlementaires. Mais cette extrême droite emprunte à son profit des programmes et des pratiques venus de l'extrême gauche : l'appel au peuple, donc, et la critique des élites, le sens du parti de masse, qu'on l'appelle « ligue » ou autrement, la préoccupation du « petit » contre le « gros » et la promesse de l'« extinction du paupérisme », pour reprendre la formule de Louis-Napoléon Bonaparte.
À vous entendre, il n'y aurait donc pas de populisme de gauche ?
Certains, comme Chantal Mouffe, parlent, depuis peu, de « populisme de gauche », mais puisqu'il ne s'agit jamais que de définition, de taxinomie, je m'en tiens à la mienne, qui permet d'être clair : dans une acception plus large, le terme « populisme » perd toute consistance ; à la limite, ce n'est qu'un synonyme pompeux de concepts sans pertinence comme « démagogie ». Chávez et Maduro ne sont pas des populistes, mais des leaders de la gauche radicale, descendants d'une longue tradition. Ce que je vois surtout, c'est que récupérer in extremis la notion en la positivant – alors que chez moi elle n'est ni positive ni négative, mais purement phénoménologique – est un aveu : l'aveu de l'effondrement intellectuel de toute une gauche radicale qui n'ose plus s'adosser à sa généalogie propre et, en particulier, à la théorie marxiste. Se réclamer d'un populisme de gauche en est à des années-lumière. Lénine doit s'en retourner dans son mausolée. En tous les cas, si l'on suit ma définition, on comprend aisément que le fait, pour un dirigeant, un militant ou un électeur, d'avoir commencé son parcours politique à l'extrême gauche peut offrir certaines prédispositions pour devenir un leader populiste. Benito Mussolini commence à la gauche de la gauche italienne. Son prénom même est un témoignage de l'engagement internationaliste de son père puisque c'est un hommage à Benito Juárez, le résistant – métis, de surcroît – mexicain, vainqueur des Français et des monarchistes.
S'agissant de Mussolini, la « bascule » de l'extrême gauche vers l'extrême droite s'opère très rapidement...
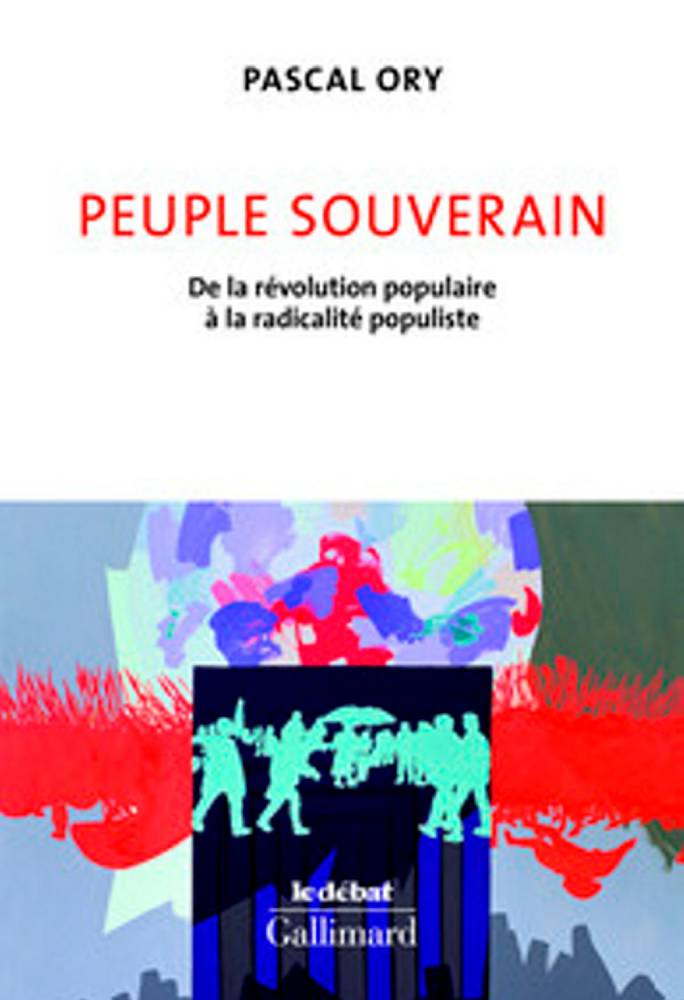
"Le populisme est une idéologie de synthèse qui permet à la droite de trouver le chemin des classes populaires en adoptant un style de gauche ; la radicalité est une mythologie qui rapproche les extrêmes dans un rejet commun de la réforme et du compromis (...). Dans certaines conditions de température et de pression politiques la radicalité de gauche ou la radicalité populiste peuvent accéder au pouvoir. (...) On appelle ça une catastrophe", écrit Pascal Ory.
© DRLa coalition Ligue-Mouvement 5 étoiles en Italie montre que l'extrême droite peut cohabiter avec l'extrême gauche au sein d'un même gouvernement. Pensez-vous qu'une telle convergence soit envisageable en France ?
Ce que je viens de dire s'applique évidemment à la variante du « passage » qui est la coalition des extrêmes, ou supposés tels. Il y a encore peu d'années, le Mouvement 5 étoiles était classé par les médias standard à l'extrême gauche et la Ligue du Nord à l'extrême droite. Au reste, le projet de budget italien qui fait en ce moment tant de vagues à Bruxelles me semble très proche de ce qu'aurait été le budget de la France si La France insoumise dirigeait le gouvernement de la France : pied de nez aux règles de l'Union européenne, et affichage du « social », au moins façon panem.
La Ligue du nord est, à l'origine, un mouvement régionaliste. Vous avez consacré votre premier travail de recherche aux Chemises vertes, fondées en 1927 par Henri Dorgères : une organisation agrarienne, dont le leader était un admirateur explicite de Mussolini. Pensez-vous que les mouvements régionalistes qui se multiplient en Europe (en Catalogne, ou en Flandre) soient des épigones de cette formation populiste ?
Je comparerais plutôt le dorgérisme au poujadisme. Une variété sociologique du populisme -ici les paysans, chez Poujade les commerçants et artisans-, qui s'élargit à un projet de société autoritaire et xénophobe, en miroir inversé par rapport au mouvement ouvrier. Ces mouvements accentuent la dimension victimaire de tous les populismes : ils se présentent comme les porte-paroles du petit, victime du gros –les anciens boulangistes sont tous devenus antisémites, par exemple, à commencer par ceux qui venaient de la gauche ; on oublie que le concept même d'antisémitisme a été inventé par un intellectuel allemand d'extrême gauche, matérialiste et révolutionnaire. Le premier parti né dans l'Italie de l'après-fascisme, avant même la fin de la guerre, se réclamait, quant à lui, de « l'homme quelconque » (qualunquismo). Le dorgérisme avait des alliés régionalistes alsaciens mais n'était pas séparatiste. En revanche la plupart des séparatistes français de l'Entre-deux-guerres, en lutte contre l'establishment « jacobin », ont basculé dans la collaboration avec les fascistes italiens et les nazis allemands. En revanche les nationalismes régionaux d'aujourd'hui sont pluriels ; ils s'étendent de l'extrême droite à l'extrême gauche.
De votre point de vue, y a-t-il forcément un lien entre populisme et fascisme ?
C'est dans ma définition : le fascisme est une version extrême du populisme. Extrême en ce qu'elle tend vers un régime non seulement autoritaire mais totalitaire – c'est, par exemple, la différence entre les classiques dictateurs de droite et leurs alliés indociles que furent la Phalange pour Franco, les Croix-fléchées pour Horthy ou le PPF pour Pétain…
Le « dégagisme » qu'appellent de leurs vœux plusieurs leaders politiques, en tant qu'expression du rejet des élites, porte en lui les germes du populisme si l'on suit votre définition. Quels facteurs peuvent expliquer que l'opinion soit réceptive face à ce discours ?
L'histoire a du mal à se faire reconnaître comme science au motif qu'elle serait, par définition, in-expérimentale, et vous connaissez la métaphore d'Héraclite : on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Cela ne nous interdit pas de penser, et penser suppose qu'on classe et qu'on mette en relation, bref qu'on pose des catégories qui rendent compte de structures, dans l'espace, et de récurrences, dans le temps. Depuis 2016 (victoire du Brexit et élection de Donald Trump), la planète est entrée dans une ère populiste – j'entends par là : sous hégémonie populiste. L'élection d'Emmanuel Macron fut contre-cyclique – trait récurrent de l'histoire politique française depuis, au moins, les débuts de la Ve République (1958, 1962, 1968, 1981…) – puisqu'elle se situe politiquement au centre et se projette dans un projet explicitement pro-européen. Mais elle ne fut pas exempte de « dégagisme », en ce sens qu'il est apparu comme venant d'ailleurs, avec autour de lui certes quelques vieux briscards, mais une grande majorité de novices.
Mais encore ?
Au-delà, la vague populiste se nourrit d'une dimension essentielle, que la science politique a mis du temps à admettre, en raison de ses postulats intellectualistes et, souvent, rationalistes : le rôle capital de l'émotion en politique. Regardez l'importance du soutien des mouvements évangélistes à un Trump ou un Bolsonaro. L'évangélisme est l'équivalent religieux du populisme, et il a le vent en poupe. Ma thèse est que tout se passe comme si, après une ère « progressiste », entre 1945 et 1975, puis une ère « libérale », entre 1975 et 2015, suscitant des couches successives d'insatisfaction et, plus encore, de ressentiment, une part importante des catégories populaires et, au-delà, des individus ou des collectivités se percevant comme victimes du mouvement de l'Histoire, avaient fait le choix, pour le coup tout à fait « expérimental », du populisme. Dans mon livre, je rappelle que si la Commune de Paris n'a duré que 72 jours, l'Union soviétique a duré 72 ans. Et, là, l'expérimentation a eu le temps de se développer à l'échelle de dizaines de pays et de millions de cobayes. Voilà pourquoi le balancier n'est jamais reparti vers la gauche depuis 1975. « L'histoire du monde est le tribunal du monde », disait Schiller, repris par Hegel et par Marx. La souveraineté populaire est restée ; elle s'est même enracinée. Mais elle a changé trois fois de couleur.
Ce concept de « souveraineté populaire » est pour vous une fiction ?
La notion même de « peuple » est, par définition, une fiction. « We, the People » (formule qui ouvre la Constitution américaine) est un discours purement performatif : le peuple est ici ce qui se proclame comme tel, et ce que ceux qui prennent ainsi la parole (donc le pouvoir) pensent qu'il est. La nation est la résultante de la rencontre entre une expérience culturelle antérieure, parfois multiséculaire (la France), parfois à peine ébauchée (le Sud-Soudan), et du mythe de la souveraineté populaire, qui est la principale invention politique de la modernité. Voilà pourquoi la nation vient de la gauche… Quant au terme de « mythe », il n'est pas ici le synonyme prétentieux de mystification : un mythe est un récit interprétatif : on me raconte, je me raconte une histoire, mais pour donner du sens à mon existence. Toutes les collectivités fonctionnent au mythe comme une automobile fonctionne à l'essence. Essence est le mot !
L'épisode populiste du XIXe siècle coïncide avec l'avènement de l'« ère des foules », identifié à l'époque par Gabriel Tarde et Gustave Le Bon. Avec Internet et les réseaux sociaux, pensez-vous que nous assistions à l'émergence d'une « ère des meutes » propice à une nouvelle séquence populiste ?
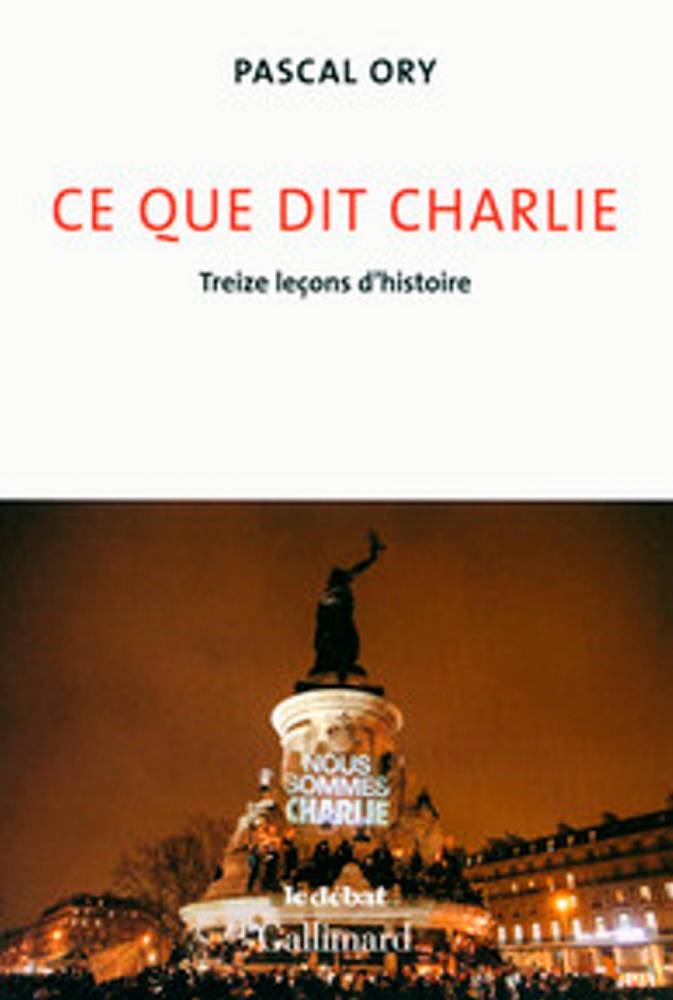
En janvier 2015, la France fut prise par surprise. Mais elle s'est, aussi, surprise elle-même. Aux deux massacres ont répondu des centaines de "marches républicaines", dont la polémique autour de ceux "qui n'étaient pas Charlie" n'a pas réussi à occulter la profonde signification politique. Pascal Ory a consacré un ouvrage passionnant à ces journées historiques.
© DRQuelle conséquence peut avoir cette poussée individualiste ?
Une dialectique de l'espace et du temps : les sociétés individualistes dans l'espace social se montrent, par ailleurs, particulièrement labiles dans le temps. Quand un grand historien méconnu comme Paul Bois, dans les années 1960, se penchait sur les structures économiques, sociales et politiques d'une société rurale de l'Ouest, il montrait la forte part de permanence qui régissait les choix de société des individus pendant deux siècles, à partir d'une rupture initiale remontant à la Révolution. Ces blocs-là ont sérieusement commencé à voler en éclats, et d'abord parce que la société qui vote – ou ne vote pas, peu importe : c'est toujours une société qui « fait de la politique » – a changé en profondeur.
Un facteur démographique joue-t-il ? Le vieillissement des populations occidentales pousse-t-il au conservatisme ?
On peut discuter l'idée, faussement rassurante pour les « élites », que le populiste est un sénior, un rural, un laissé-pour-compte et un pessimiste. D'abord parce que si l'on conjugue toutes ces catégories, distinctes ou associées dans un même électeur, cela finit par faire du monde et, par exemple, une majorité aux élections. Ensuite parce que ce n'est que partiellement vrai. Au début du XXIe siècle, l'éphémère mouvement agrégé autour de Pim Fortuyn, aux Pays-Bas, annonçait de nouvelles figures de populistes ; songez donc : un homosexuel déclaré, maître de conférences en sociologie... Des sondages récents montrent que les jeunes générations occidentales ne sont pas vaccinées contre le populisme. Et l'Inde du BJP n'est pas un pays de vieillards.
Quel impact la mondialisation des échanges peut-elle avoir sur les populismes ?
C'est un raisonnement typique du wishful thinking humaniste que de croire que la mondialisation, indéniable sur les plans technique, économique et culturel, accouchera nécessairement d'une société politique internationaliste, qu'elle soit libérale ou socialiste. D'une part, elle encourage des réactions identitaires ; de l'autre, les cristallisations nationalistes ou racistes ne sont aucunement contradictoires avec une consommation matérielle mondialisée. Si, comme je le crois, toute société vit dans le présent et en fonction de ses intérêts, elle fera passer le présent devant les supposées « leçons de l'histoire » – qui n'existent pas : on enseigne l'histoire, mais l'histoire n'enseigne rien – et ses intérêts, réels ou imaginaires, avant tout principe de non-contradiction. Comme je le disais à mes élèves quand on étudiait en direct, dans les années 1990, l'éclatement de la Yougoslavie, ce n'est pas parce que les jeunes Serbes et les jeunes Croates écoutaient la même musique rock que ça les empêchait de s'entre-égorger « ici et maintenant ».
Est-ce à dire que vous pronostiquez un retour des fascismes ?
Je ne suis pas prophète. Je constate simplement la récurrence du même triptyque menace/réaction/crise qui a provoqué les conséquences que l'on sait dans les années 1930. La menace – là aussi réelle ou fantasmée, peu importe – s'appelait dans l'entre-deux-guerres « bolchevisme » ; elle s'appelle aujourd'hui « islamisme » ; la réaction, là « fascisme », ici « populisme » ; quant à la crise, elle n'est plus aujourd'hui la grande crise économique façon 1929, gigantesque mais ponctuelle, mais la grande crise écologique prolongée diagnostiquée par les experts. Elle accélère déjà la remontée du Sud vers le Nord – avec les effets populistes que l'on voit – et, à l'échelle de la planète, paraît peu propice à l'épanouissement de régimes de liberté. En un mot : la crise écologique fera sans doute progresser la conscience écologique des Terriens, mais plus rapidement encore leurs réflexes autoritaires, voire totalitaires. Dans cette hypothèse, nous aurons des « années 1930 » étendues à l'échelle de la planète et à celle d'un siècle, voire plus – à supposer que l'humanité survive au siècle en question.
*Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste, Gallimard, 250 pages, 21 euros
**Ce que dit Charlie, treize leçons d'histoire, Gallimard, 248 pages, 15,9 euros.

Et alors, le populisme c'est bien. Il nait de l'incompétence des responsables qui ne respectent pas leurs engagements. C'est l'expression de la volonté du peuple. C'est la démocratie.
@FIK6T : "les causes : l'immigration clandestine, la mondialisation sauvage, l'accaparement des richesses par une minorité, la confiscation du pouvoir par les lobbys soutenus par des bureaucrates, la naïveté stupéfiante des nos gouvernements, etc. "
@ 13mai1958 : "Devient l'incivique " indignez vous " des intouchables " insoumis ", antifa, zadistes, femen et autres " palestinistes de Barbés " et autre secte californienne... Padamalgam ? "
Et sans doute bien d'autres, les réponses au pourquoi le "Populisme" sont là... Hélas !
Cdt.
D'occident ont assez subi les mefaits de l'" Internationale " apatride anti occident gauchiste... Pour se mefier de ceux pour qui la "Nation française " est un " mal absolu " et toute autre identité etrangere chez nous c'est le souverain Bien !
Moliere n'est plus pour denoncer nos tartuffes " bobo haram " d'ici et les " bokos haram " de la dekolonisation de substitution.
Dekolonisation (de l'occident) forcement " heureuse " sous peine de procés stalinien en blasphème... Comme jadis au bon temps du " goulag heureux " vu de Montreuil et de nos sartriens debiles menteurs.