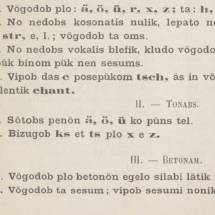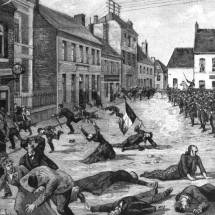Le manifeste pionnier de Zola en faveur d'un journalisme engagé

En 1881, Émile Zola annonce qu'il quitte le journalisme dans un article intitulé « Adieux ». Un texte qui s'affirme comme une véritable déclaration d'indépendance de l'artiste engagé, en même temps qu'un plaidoyer en faveur de la presse.
Le 22 septembre 1881, Le Figaro publie un article d’Émile Zola intitulé « Adieux ». Après un an passé à signer des chroniques dans le quotidien, le célèbre écrivain y annonce qu'il tire sa révérence. Entré dans le journalisme en 1863, Zola le quitte l'année même où est adoptée la loi sur la liberté de la presse (le 29 juillet).
Les « Adieux » de Zola, parus en Une du journal, se révèlent un texte à la fois personnel et très politique. Personnel parce que l'auteur de L'Assommoir et de Germinal y livre un bilan émouvant de ses quelque 18 années passées à ferrailler dans les pages des journaux, y rédigeant jour après jour des centaines de chroniques, portraits, compte-rendus, reportages, pamphlets et critiques.
Politique parce que ces adieux sont aussi un manifeste vibrant pour un journalisme de contre-pouvoir.
« Me voici au terme. J'ai tenu la promesse que je m'étais faite de batailler ici pendant une année, et j'estime à cette heure que cela suffit. Quand j'ai accepté l'hospitalité si large du Figaro, ma pensée a été d'y venir défendre, à la tribune la plus retentissante de la presse, devant le grand public, quelques idées bien simples et peu nombreuses, qui me tenaient au cœur.
Mon sentiment est que le triomphe d'une idée unique demande la vie d'un homme. Mais il faut compter avec les exigences légitimes d'un journal, et pour le succès même de ma cause, je préfère ne pas me répéter, ayant dit en somme tout ce que j'avais à dire. »
Revenant sur son année au Figaro, Zola explique que son combat a d'abord été celui d'un républicain, prompt à dénoncer tous les dévoiements de la jeune et encore fragile IIIe République – et ce au sein même d'un journal pourtant conservateur. Sa cible première : les hommes politiques, qu'il englobe dans un même mépris et dont il fit un portrait à charge particulièrement virulent dans un article paru en octobre 1880, « L'encre et le sang ».
« En politique, j'ai dit toute ma haine de la médiocrité bruyante, des ambitions exaspérées qui se satisfont au détriment de la tranquillité nationale. On m'a reproché d'y avoir mis de la violence. Suis-je réellement allé trop loin ? Les lecteurs ont-ils pu se méprendre sur mes véritables sentiments ?
La République n'a jamais été en cause dans mes discussions. Je la crois le seul gouvernement juste et possible. Ce qui a toujours soulevé mon cœur, c'est la bassesse et la bêtise des hommes. Je ne suis pas un politique, je n'ai pas de parti à ménager. Je puis dire nettement leur fait aux petits hommes qui passent ; et si l'on m'accuse de frapper sur la République en frappant sur les gens qui la salissent ou qui la mangent, je répondrai qu'elle se portera mieux, lorsque chaque matin elle se débarbouillera et se donnera un coup de peigne [...].
Ma colère est là, dans le pullulement de ces parasites, dans le vacarme assourdissant qu'ils déchaînent, dans ce spectacle honteux d'un grand peuple mangé par des hommes sans talent aucun, ayant à satisfaire la terrible faim de leur ambition toujours déçue. »
Plus loin, l'écrivain-journaliste réaffirme la supériorité de la littérature et de l'art sur la politique :
« Et voilà pourquoi j'ai réclamé si hautement la priorité des lettres. Elles seules règnent éternellement. Elles sont l'absolu, tandis que la politique est le relatif.
Dans nos temps troublés, les hommes politiques prennent, grâce à l'effarement de la nation, une importance considérable et malsaine, qu'il faut combattre. Ces pantins d'une heure, ces instruments presque toujours inconscients d'un résultat qu'ils n'ont pas prévu, doivent être ramenés à leur taille, si l'on ne veut pas que le pays se détraque devant leur parade.
Non, ils ne sont pas tout ! non, ils ne tiennent pas l'époque, car l'époque est aux savants et aux écrivains ! Tel est le cri que je voudrais faire continuellement entendre, au-dessus de la politiquaillerie actuelle. Votre tapage tombera, nos œuvres resteront. Vous n'êtes rien, nous sommes tout. »
S'ensuit un long passage sur le naturalisme, courant littéraire dont Zola est le chantre et qu'il a défendu dans les journaux face à une critique souvent hostile (il avait d'ailleurs cloué au pilori cette dernière dans un texte paru en 1880, « Impuissance de la critique »).
Puis son texte s'achève sur une célébration de la presse de son temps, une presse qu'il défend avec ardeur malgré ses défauts.
« Tels sont mes adieux. Mais, je le confesse, au moment de remettre mon grand sabre au fourreau, je suis pris du regret de la bataille, malgré les lassitudes et les dégoûts qu'elle m'a souvent apportés.
Depuis plus de quinze ans, je me bats dans les journaux. D'abord, j'ai dû y gagner mon pain, très durement ; je crois bien que j'ai mis les mains à toutes les besognes, depuis les faits divers jusqu'au courrier des Chambres. Plus tard, lorsque j'aurais pu vivre de mes livres, je suis resté dans la bagarre, retenu par la passion de la lutte. Je me sentais seul, je ne voyais aucun critique qui acceptât ma cause, et j'étais décidé à me défendre moi-même ; tant que je demeurerais sur la brèche, la victoire me semblait certaine. Les assauts les plus furieux me fouettaient et me donnaient du courage.
À cette heure, j'ignore encore si ma tactique avait du bon ; mais j'y ai au moins gagné de bien connaître la presse. Mes aînés, des écrivains illustres, l'ont souvent foudroyée devant moi, sous de terribles accusations : elle tuait la littérature, elle traînait la langue dans tous les ruisseaux, elle était l'agent démocratique de la bêtise universelle. J'en passe et des plus féroces.
J'écoutais, je songeais que, pour en parler avec cette rancune, ils ne la connaissaient pas ; non, certes, qu'elle fût absolument innocente de tout ce qu'ils lui reprochaient, mais parce qu'elle a des côtés puissants et qu'elle offre des compensations très larges.
Il faut avoir longtemps souffert et usé du journalisme, pour le comprendre et l'aimer. »
Et de conclure :
« À tout jeune écrivain qui me consultera, je dirai : “Jetez-vous dans la presse à corps perdu, comme on se jette à l'eau pour apprendre à nager.” C'est la seule école virile, à cette heure ; c'est là qu'on se frotte aux hommes et qu'on se bronze ; c'est encore là, au point de vue spécial du métier, qu'on peut forger son style sur la terrible enclume de l'article au jour le jour.
Je sais bien qu'on accuse le journalisme de vider les gens, de les détourner des études sérieuses, des ambitions littéraires plus hautes. Certes, il vide les gens qui n'ont rien dans le ventre, il retient les paresseux et les fruits secs, dont l'ambition se contente aisément. Mais qu'importe ! Je ne parle pas pour les médiocres ; ceux-là restent dans la vase de la presse, comme ils seraient restés dans la vase du commerce ou du notariat.
Je parle pour les forts, pour ceux qui travaillent et qui veulent. Qu'ils entrent sans peur dans les journaux : ils en reviendront comme nos soldats reviennent d'une campagne, aguerris, couverts de blessures, maîtres de leur métier et des hommes [...].
Dans la presse, il arrive qu'on tombe de la sorte sur des mares d'imbécillité et de mauvaise foi. C'est le côté vilain et inévitable. On y est sali, mordu, dévoré, sans qu'on puisse établir au juste s'il faut s'en prendre à la bêtise ou à la méchanceté des gens. La justice, ces jours-là, vous semble morte à jamais ; on rêve de s'exiler au fond d'un cabinet de travail bien clos, où n'entrera aucun bruit du dehors, et dans lequel on écrira en paix, loin des hommes, des œuvres désintéressées.
Mais la colère et le dégoût s'en vont, la presse reste toute puissante. On revient à elle comme à de vieilles amours. Elle est la vie, l'action, ce qui grise et ce qui triomphe. Quand on la quitte, on ne peut jurer que ce sera pour toujours, car elle est une force dont on garde le besoin, du jour où l'on en a mesuré l'étendue.
Elle a beau vous avoir traîné sur une claie, elle a beau être stupide et mensongère souvent, elle n'en demeure pas moins un des outils les plus laborieux, les plus efficaces du siècle, et quiconque s'est mis courageusement à la besogne de ce temps, loin de lui garder rancune, retourne lui demander des armes, à chaque nécessité de bataille. »
Une conclusion prophétique : Zola mettra strictement en application ce programme quand il reviendra lors de l'affaire Dreyfus, plus de quinze ans après ces « adieux ». Son « J'accuse !... », publié dans L'Aurore le 13 janvier 1898, reste un modèle de journalisme, un texte qui contribua à façonner la figure de l'intellectuel engagé et qui demeure aussi, probablement, l'article le plus célèbre de l'histoire de la presse française.
–
Pour en savoir plus :
Émile Zola, Zola journaliste : articles et chroniques, Flammarion, 2011
Alain Pagès, Émile Zola, de « J'accuse » au Panthéon, Éditions Lucien Souny, 2008
Pascal Ory et Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France de l'affaire Dreyfus à nos jours, Armand Colin, 1986