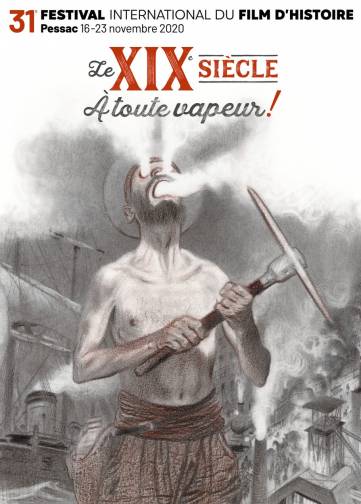Les formes extrêmes de la résistance à l’esclavage ont bien sûr été les révoltes et les insurrections, dont une cartographie laisse peu d’espaces vides : de plantation en plantation et d’île en île, il y eut bien peu de périodes calmes dans l’univers de l’esclavage colonial. L’historien et homme politique martiniquais Édouard Delépine a parfaitement résumé cet état de fait, trop longtemps minimisé ou négligé par les recherches historiques des années 1960 à 1990 :
« Les planteurs antillais ont rarement dormi sur leurs deux oreilles. [...] L’histoire de l’esclavage avait été ponctuée d’actes de rébellion et de révoltes plus ou moins violentes, notamment depuis la révolution haïtienne. »
Malgré leur fréquence et leur intensité, toutes ces insurrections ont été vaincues, réprimées, et leurs instigateurs et acteurs impitoyablement massacrés ou jugés de façon expéditive. Makandal à Saint-Domingue ou Nat Turner en Virginie, de même Boukman à Saint- Domingue, en 1791, sont restés dans les mémoires comme des figures mythiques, incarnations du héros libérateur, mais finalement vaincu.
Enfin, ce que l’on appelle aujourd’hui les « résistances culturelles » reflète en profondeur le refus des populations déportées par la traite, mais aussi les générations suivantes, d’adopter pleinement les valeurs imposées par l’ordre colonial. Dès son arrivée sur les plantations, l’esclave devait changer d’identité. Baptisé, il devait rompre avec sa religion. Doté d’un nouveau nom, il devait oublier le sien, ainsi que sa langue ; enfin, musiques et danses d’Afrique lui étaient interdites, étant considérées comme superstitions, voire prétextes à com- plots. L’esclave était déculturé, dépouillé de sa vie intérieure, contraint de se plier aux nouvelles normes imposées par celui qui avait acheté sa force de travail et la totalité de sa personne. En réalité, cette acculturation imposée n’a jamais été totale : sous de multiples formes, les cultures africaines ont survécu et se sont transformées en intégrant des éléments chrétiens, voire musulmans ; les musiques et les danses se sont perpétuées, souvent clandestinement, de même que les pratiques médicinales à base de plantes. La formation des langues créoles elles-mêmes a été l’une des traductions du refus d’assimiler l’identité des maîtres, et un moyen de communiquer sans être compris de ces derniers. Ces formes immatérielles du refus par l’esclave de son statut de déraciné par la force ont perduré dans bon nombre de sociétés issues de l’esclavage, à Cuba, en Haïti, au Brésil, en Jamaïque.
Ce tableau est bien incomplet, mais le rappel de cette composante majeure du processus de refus de l’esclavage, ancré au plus profond des êtres humains transformés en « biens meubles », est indispensable pour prendre la mesure du long processus de destruction de l’esclavage. Le mouvement abolitionniste né dans les métropoles coloniales au cours du XVIIIe siècle ne pouvait ignorer ces multiples formes de résistances, consubstantielles à un esclavage mis en place sous la forme d’une déportation d’êtres humains arrachés à leurs sociétés et reposant exclusivement sur un critère racial : l’esclave déporté vers les colonies est toujours Africain. Cette racialisation est un phénomène unique dans la longue histoire de l’esclavage.
Aucune des insurrections d’esclaves n’a pu détruire l’esclavage, hormis celle de Saint-Domingue entre 1791 et 1803, qui d’abord imposa l’abolition puis l’indépendance ; mais il n’en demeure pas moins essentiel d’en rappeler l’importance, la durée et le rôle dans l’affirmation des identités africaines au sein des colonies des Nouveaux Mondes.
–
Les Abolitions de l’esclavage est publié aux Presses Universitaires de France (PUF).