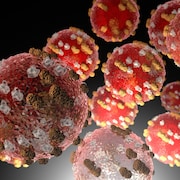Un jour jusqu'à la fin de mes jours, de François Marcotte, finaliste du Prix du récit 2019

L'auteur François Marcotte
Photo : Odile Pelletier
Prenez note que cet article publié en 2019 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.
À 46 ans, lourdement paralysé par la sclérose en plaques, François Marcotte vit en CHSLD. Il pose un regard lucide et poétique sur un milieu de vie qui ne devrait pas être le sien, faisant de l'écriture son acte de libération et de résistance.
Les opinions exprimées par les auteurs et autrices ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certaines personnes pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez noter que certains textes s'adressent à un public averti.
Un jour jusqu'à la fin de mes jours
J’avais vingt-deux ans. Des taches blanches ont été repérées sur des photographies de mon cerveau et de ma moelle épinière. Des taches qui se sont multipliées avec le temps, qui ont court-circuité le signal du système nerveux. Aux bras. Aux mains. Aux doigts. Aux jambes. Aux pieds.
J’ai quarante-six ans. Je suis paralysé du cou aux pieds, mon corps est une prison. Par bonheur, ma voix me libère. Voici mon évasion.
*
Il est à peine dix-huit heures. J’ai zappé, navigué, lu et écrit toute la journée. Je suis fatigué, je veux me mettre au lit. Je donne un coup de la pommette gauche sur un bouton noir pour tirer le fauteuil motorisé du sommeil, je frôle avec ma tempe droite le capteur qui englobe ma tête, le fauteuil pivote de quarante-cinq degrés. J’appuie une nouvelle fois mon crâne, le fauteuil roule d’une trentaine de centimètres, touche la cloche d’appel. La voix d’un préposé sort du haut-parleur mural :
— Ça ne sera pas long…
C’est l’heure de pointe au CHSLD. Les préposés dégainent leur téléphone qui sonne sans cesse, courent au secours de personnes vacillantes qui risquent de chuter, viennent en aide à celles qui veulent aller à la toilette, se coucher ou qui ont appuyé sur la cloche sans savoir pourquoi. Une marchette glisse puis racle le linoléum. C’est madame L. Jour après jour, elle pousse sa marchette d’est en ouest, bifurque dans l’aile nord et effectue un cent quatre-vingts degrés au bout du corridor, devant la porte de ma chambre. Je n’ai pas à m’en méfier, jamais elle ne la pousse.
Ce n’est pas le cas de madame K., la mémoire cassée, et de monsieur V., les yeux vitreux, le regard fuyant, prisonnier de la démence (je suis troublé chaque fois que je le regarde : il est plus jeune que mon père). Ils jouent avec la poignée, entrent et s’approchent de mon lit. J’appuie sur la cloche pour qu’on vienne les chercher.
— Ça ne sera pas long…
Avant longtemps, c’est la mort qui viendra les chercher. La durée moyenne du séjour est de deux ans.
Quant à moi, j’habite au CHSLD depuis presque quatre ans. Mille trois cent vingt-huit jours et autant de nuits pour être exact.
À mon arrivée, j’étais le plus jeune. Je le suis encore. Mon espérance de vie est à peine inférieure à celle des hommes de mon pays. J’ai donc à peu près trente années devant moi avant de mourir ici.
On cogne à la porte. Le préposé attitré à l’aile nord me rejoint à l’ordinateur et enlève le casque d’écoute autour de mon cou. Je donne des coups de la pommette, bouge la tête sur les capteurs. J’arrive de l’autre côté du lit, je me stationne. Il met le fauteuil hors tension, glisse une toile derrière mon dos et sous mes cuisses, accroche les quatre boucles des courroies au lève-personne, appuie sur un bouton. La mécanique d’acier et d’électricité m’arrache du fauteuil et me soulève, puis je glisse sous le rail au plafond. Le préposé me dépose sur le matelas, me tourne sur le flanc droit, me débarrasse de la toile. Je tourne le dos à la porte et à un monde qui ne devrait pas être le mien. La fenêtre face à moi s’ouvre sur une vision fantomatique : la neige soufflée du toit voile le début de la soirée. L’hiver tempête, ça me calme, je ferme l’œil.
Sauf que ma cuisse gauche, le mollet et le bas du genou sont secoués par des décharges électriques. J’appréhende la nuit : elle sera blanche et électrique. Encore une fois.
Vers vingt heures, je donne un coup de tête sur la cloche. Je veux qu’on me mette sur le dos et qu’on redresse la tête du lit.
— Ça ne sera pas long…
Quand le préposé a achevé l’opération, il installe le casque d’écoute autour de mon cou. Ça y est, je vais pouvoir zapper, naviguer, lire, écrire.
Vingt-trois heures trente. J’ai attendu l’équipe de nuit pour dormir. Une équipe de deux veillera sur trente-deux résidents jusqu’à six heures trente.
J’ai appuyé sur la cloche à quatre reprises au cours de la soirée. Une fois pour qu’on replace ma jambe gauche, les trois autres, pour boire de l’eau. J’avais la gorge asséchée à force de parler, je devais m’hydrater. Des larmes brûlent mes paupières, coulent. Mes yeux rivés à l’écran de l’ordinateur sont fatigués, desséchés et irrités, mes paupières, de sable.
— Ça ne sera pas long…
Le préposé me brosse les dents, me couche sur le flanc gauche. À peine une demi-heure plus tard, ma cuisse gauche et le bas du genou sont la proie de décharges électriques.
Décharge.
La jambe gauche se contracte, se détend.
Vingt-cinq secondes.
Décharge.
La jambe gauche se contracte, se détend.
Vingt-cinq secondes.
Décharge.
La folle électricité a gagné mon épaule droite. Le bras se rebelle.
Vingt-cinq secondes.
Décharge.
Le bras se rebelle à nouveau, j’ai la sensation que des ongles griffent ma peau.
Je gonfle mes poumons, retiens mon souffle, mes tempes bourdonnent. Je relâche mon souffle après une vingtaine de secondes. Mon cœur s’emballe. J’ai chaud. Ma gorge est sèche et serrée. J’avale le peu de salive qui me reste en espérant qu’elle ne passe pas de travers dans le larynx.
Décharge.
Mon corps s’est réchauffé, je me suis énervé. J’inspire profondément, expire lentement.
Je réussis à dormir.
Réveillé par une colonne vertébrale tordue et une épaule endolorie, j’appelle à l’aide pour filer jusqu’au matin sur le dos. Soulagé, je me rendors, mais je me réveille en sursaut.
Décharge.
La jambe gauche se plie et se déplie, le talon racle le drap.
Vingt-cinq secondes.
Décharge.
La jambe gauche se plie et se déplie, le talon racle le drap, la peau est sensible. J’ai mal.
Les yeux tournés vers le ciel de la chambre, je fixe le rail, et comme souvent, je me dis que je suis une vieille carcasse. Là, je rêve d’apesanteur. Je m’arrache à la gravité qui me plaque au matelas, je plane dans l’air, me dirige vers les murs et le plafond contre lesquels je pousse en appuyant les doigts et la paume des mains. Ça me propulse. Mon corps exécute des vrilles, des trois cent soixante degrés de liberté.
Les décharges s’espacent. Je me sens léger et apaisé.
L’aile nord est endormie. Du silence jaillissent des mots. Je construis des phrases, puis je leur donne de nouvelles tournures. Même que certaines sont somptueuses. J’en suis fier, je les grave dans ma mémoire. Je les dicterai à l’ordinateur.
Avant la découverte de la sclérose en plaques, et même au début de la maladie, mes mains volaient et se croisaient au-dessus du clavier, les doigts souples tapotaient les touches avec légèreté, faisaient des raccourcis, réalisaient de grands écarts en rejoignant lettres et symboles. La souris glissait sur son tapis et animait le curseur, je cliquais et double-cliquais à gauche et à droite.
Puis les doigts gauches se sont graduellement recroquevillés jusqu’à devenir un poing qui ne s’ouvre plus, ceux de droite ont exigé des gestes réfléchis. Je me concentrais et visualisais les touches du clavier, serrais la mâchoire, déposais des doigts hésitants. Les grands écarts étaient laborieux, les clics et les doubles-clics se faisaient attendre, je me débattais avec la souris.
Mon corps se réchauffait, j’étais à bout de force, de plus en plus silencieux.
Sept heures trente. Bonne comme mauvaise nuit, je donne un coup de tête sur la cloche à peu près à cette heure-là.
— Ça ne sera pas long…
Quand le préposé de jour fait son entrée, il démarre l’ordinateur, me remonte sur le matelas, redresse la tête du lit, déplace la table à roulettes sur laquelle est posé l’ordinateur, place l’écran devant mes yeux, installe le casque d’écoute, tourne le microphone devant ma bouche. Il répond aux cloches qui se réveillent, vole à la rescousse des neuf autres résidents de l’aile nord. Il reviendra pour le déjeuner.
Au travail.
Le logiciel de reconnaissance vocale est lancé, ma voix est aux commandes de l’ordinateur.
J’appelle le logiciel de courriel, le navigateur web.
J’appelle des signets, j’épelle des www dans la barre d’adresse.
Damier de souris.
Un quadrillage de neuf cases, chacune identifiée par un chiffre, recouvre l’écran. Le curseur de la souris se trouve au centre du centre, sur la case cinq. J’appelle un chiffre. La case se subdivise en neuf nouvelles cases, le curseur se place au centre du centre, sur la case cinq.
Je découpe mentalement l’écran, je place des damiers, je positionne le curseur sur des icônes.
Souris clic.
J’allume la télévision et je zappe. J’ouvre des logiciels, des fichiers et des dossiers.
Mon esprit est envahi de rectangles, de carrés, de grilles et de lignes qui se croisent, de formules et de codes que j’ai mémorisés pour déplacer le curseur. À l’horizontale, à la verticale, de biais à gauche ou à droite. Pour qu’il aille plus vite ou qu’il s’arrête.
La journée est lancée, le travail est commencé.
C’est à neuf heures que le préposé apporte le déjeuner au lit. Il fait couler du café de la machine espresso. Une odeur réconfortante flotte dans la pièce. Il porte à ma bouche les deux rôties au beurre d’arachide, le café et le jus d’orange. J’avale tout en moins de cinq minutes.
Mon corps se réchauffe, je me sens avachi, ma tête tombe vers l’avant. Le préposé plombe mes oreilles avec des bouchons, me tourne sur le flanc droit, s’en va. Silence.
La routine quotidienne reprend son cours à dix heures vingt. Entre-temps, j’ai dormi quelques minutes. Le préposé procède à ma toilette, se tient ensuite debout entre le lit et la commode, se demande dans quel tiroir plonger les mains. Il n’a pas besoin de parler, je lui dis :
— Je n’irai pas dehors.
En ce lendemain de tempête, les roues pourraient s’enliser dans la neige et le froid est mordant. Il sort un jean et un t-shirt, m’habille.
Onze heures. Le préposé glisse une toile derrière mon dos et sous mes cuisses, accroche les boucles des courroies au lève-personne, appuie sur un bouton. Le lève-personne me soulève, je glisse sous le rail jusqu’au-dessus du siège du fauteuil motorisé et il me dépose sur le siège. Le préposé boucle la ceinture autour de ma taille, enlève la toile, met le fauteuil sous tension. Après avoir donné des coups de la pommette gauche, ma tête me conduit au lavabo où le préposé me brosse les dents, me donne un coup de peigne, applique une crème hydratante sur mon visage. Je tire le fauteuil du repos, me mets en route, tourne à droite et me stationne entre la fenêtre et le lit. L’homme dans la jeune trentaine accroche la cloche d’appel à un montant du lit, déplace la table de l’ordinateur juste en face de moi, installe le casque d’écoute autour de mon cou. Je le reverrai à midi pour le dîner, je lui dirai non merci, je n’ai pas le temps, j’ai du travail.
Je donne deux coups de la pommette gauche sur le bouton noir, je frôle avec ma tempe droite le capteur, l’assise du fauteuil bascule vers l’arrière. Je m’arrête à vingt degrés.
Le soleil est froid à la vitre. Du troisième étage, je plonge dans les épinettes qui ploient sous la neige et bougent avec une certaine souplesse. La forêt est magnifique, je frissonne, c’est calme. Au travail
.
J’appelle le traitement de texte. Ouvrir un fichier.
Un menu s’affiche. Un jour.
Le fichier s’ouvre. Fin du document.
Le curseur clignote au bas de la dernière page, je lis le paragraphe précédent.
Après un moment de réflexion, je parle, des mots apparaissent à l’écran et s’ajoutent aux phrases et aux paragraphes.
Ma voix a remplacé mes mains et mes doigts.
Je zappe, navigue, lis, écris. J’écris un récit.
Découvrez les autres finalistes du Prix du récit (histoires vécues) Radio-Canada 2019
Véritable tremplin pour les écrivaines et écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada (Nouvelle fenêtre) sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles (fictions) et poèmes inédits soumis au concours.
Vous aussi, vous avez une histoire vécue à raconter? Participez au Prix du récit Radio-Canada!
La période d'inscription pour le Prix du récit Radio-Canada 2020 se termine le 29 février 2020.