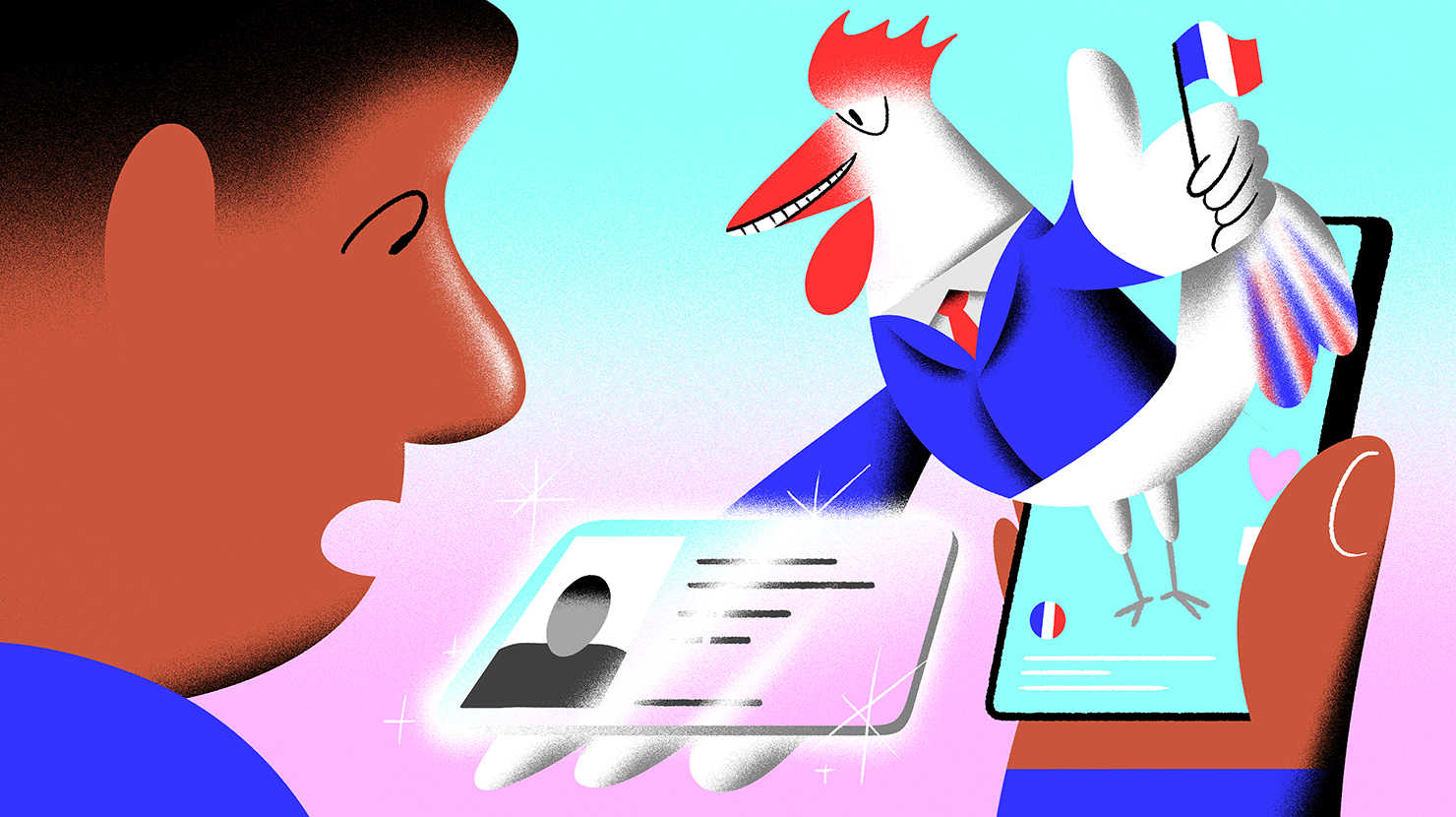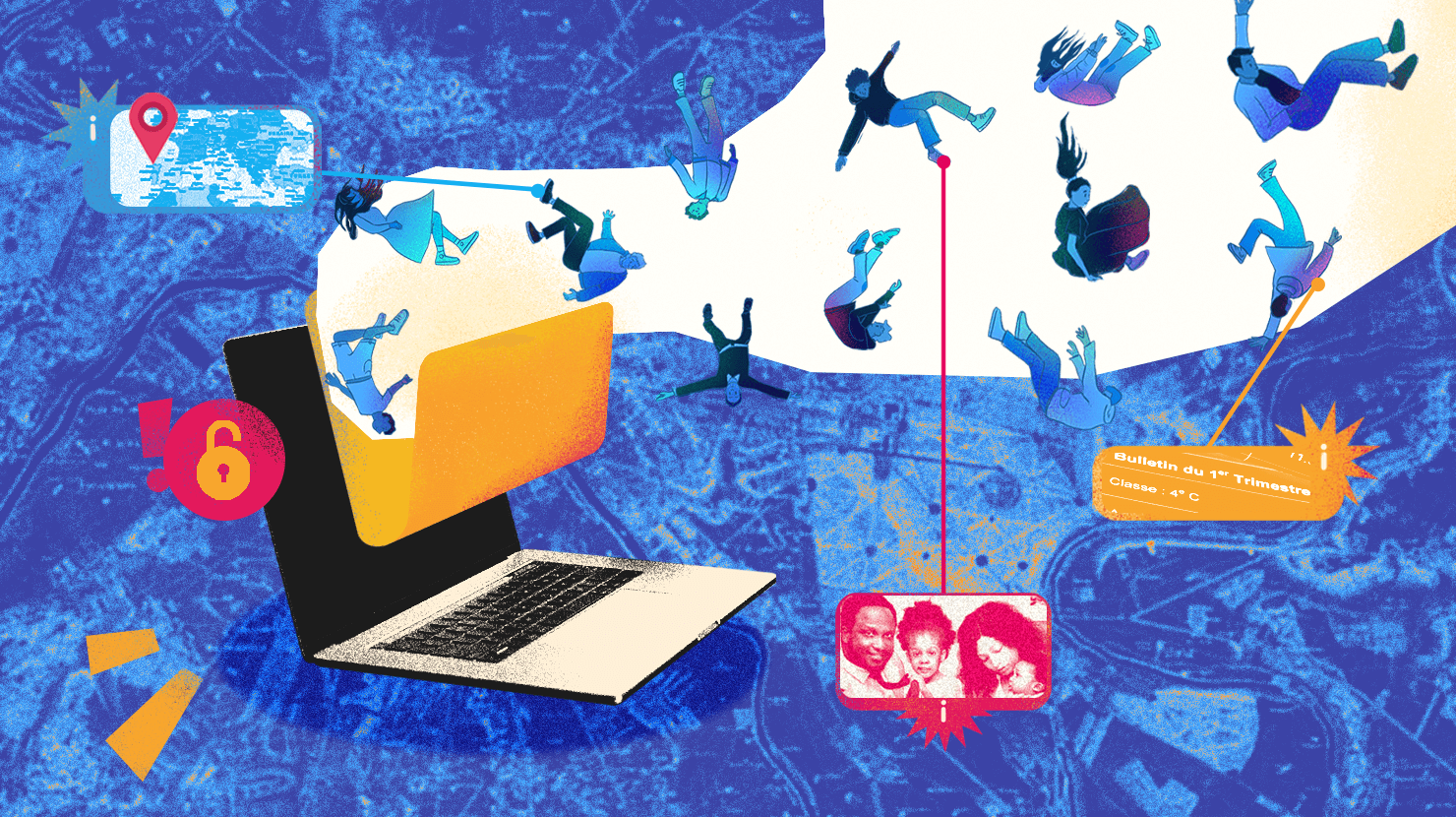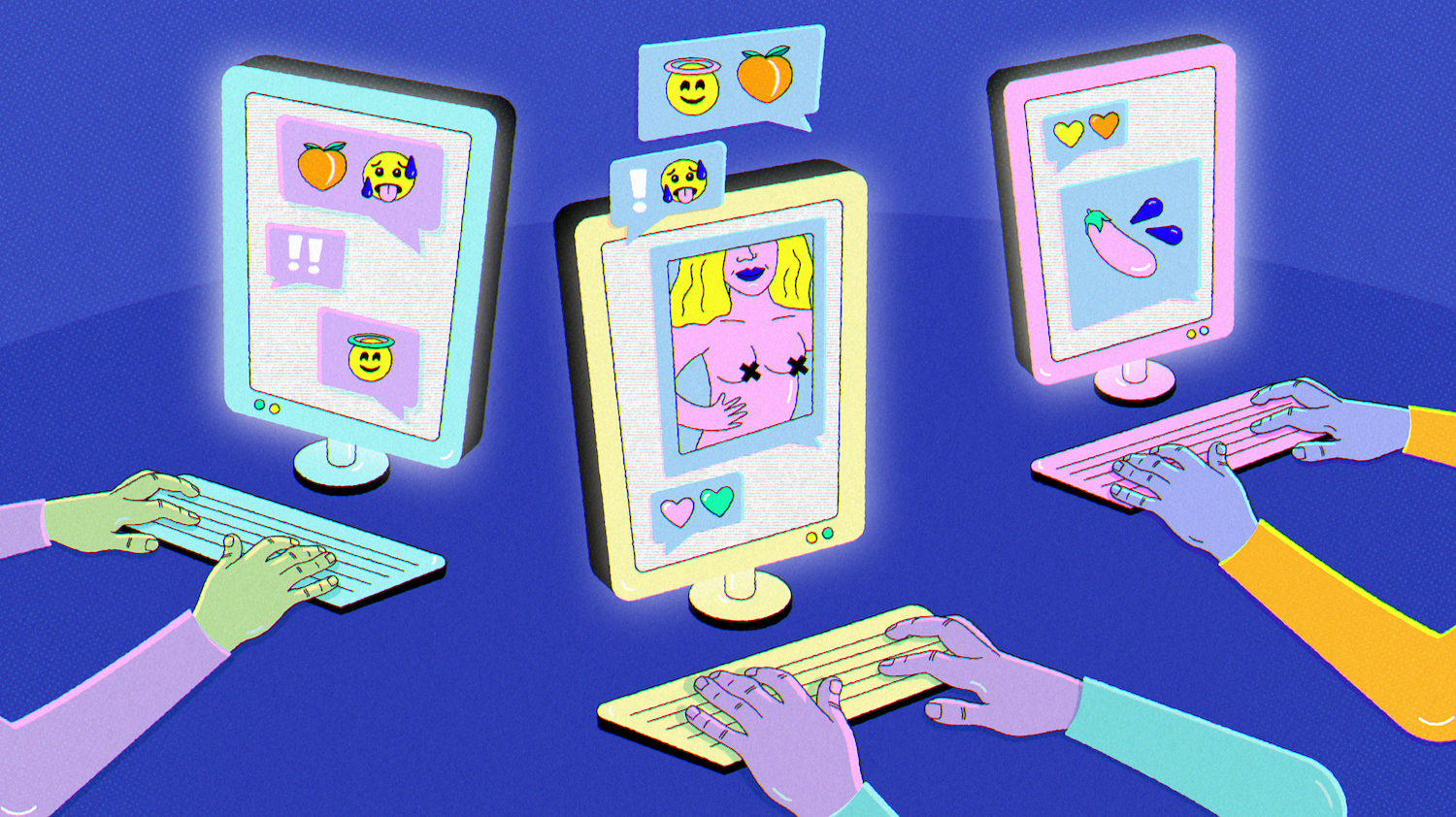Kahani (97-6) – Il ne lui reste plus que sa dignité, immense. Elle irradie la seule pièce de sa maison aux murs de ciments bruts et au lino en charpie. Fatima est là, assise sur le bord de son lit aux draps blancs et soigneusement tirés. C’est sur ce même lit qu’elle a retrouvé son bébé suffoquant, vendredi dernier. Ce jour-là, le village de Kahani est plongé dans la violence et les gaz lacrymogènes. « Ça tirait de partout. On ne voyait plus clair dans la maison. Quand je suis arrivé près du lit, j’ai vu que la petite avait changé de couleur », se remémore la maman, prostrée dans la pièce sombre qui lui fait écho.
Malgré le chagrin immense qui l’habite, Fatima se souvient avec précision de cette matinée. Comme si elle avait pu une dernière fois mesurer le temps avant qu’il ne s’envole. Il est 6h quand l’un de ses fils part pour aller prendre le bus et se rendre au collège. « Quelques minutes plus tard, il devait être 6h03 ou 6h04, il est revenu en courant en disant que ça chauffait dehors », raconte en shimaoré la mère de famille.
À une centaine de mètres de la maison où Fatima vit encore avec ses sept enfants, des scènes de guérilla urbaine tétanisent le village. Point de départ de l’émeute, le pôle d’échange des bus scolaires venus des quatre coins de l’île. Lesquels sont attaqués par des dizaines de jeunes cagoulés et armés de bâtons à clous ou autres machettes. Des lycéens sont pourchassés et attaqués dans leur lycée dans un déchaînement de violence jamais atteint sur ce site pourtant familier des affrontements. Tout le monde est pris de court, à commencer par la gendarmerie. En sous-effectif le temps que les renforts arrivent – ils seront près d’une cinquantaine au total –, les militaires tentent tant bien que mal de contenir les groupes à grand renfort de gaz lacrymogènes. On leur répond par une grêle de pierres grosses comme la main. Le genre de scènes qui se répètent chaque semaine depuis près de deux mois dans différents villages du département français.

La maison de Fatima à Kahani, où elle vit encore avec ses sept enfants. / Crédits : Gregoire Merot
« À ce moment-là, j’étais aux toilettes. Quand je suis sortie, j’ai vu des jeunes s’engouffrer dans ma rue, juste devant la maison. Instantanément, il s’est mis à pleuvoir des cartouches de gaz, ça n’arrêtait pas », détaille la mère endeuillée. L’épaisse fumée envahit sa maison en s’engouffrant par les fenêtres grandes ouvertes. Une voisine propose alors à Fatima de venir se réfugier chez elle avec son bébé. « Quand je suis allée le prendre, il avait rougi très fort, j’ai compris tout de suite que ça n’allait pas du tout », se souvient-elle, revivant le trauma qu’elle cache tant bien que mal sous un kishali, le voile traditionnel, en berne.
« Elle s’appelait Mohamadi »
« Le bébé était déjà malade, il avait de la fièvre et du mal à respirer. Je l’ai emmené quelques jours plus tôt au dispensaire où l’on m’avait donné des médicaments. Depuis, mon enfant allait vraiment mieux », se rappelle Fatima. Devant la détresse de son bébé, elle retourne au pas de course au dispensaire, son enfant dans les bras, entre les gaz et les pierres. Après avoir négocié avec les émeutiers qui acceptent de la laisser passer.
Pris en charge dans un délai jugé trop long par sa mère, l’enfant décédera quelques dizaines de minutes plus tard. Sa vie s’envolera entre les mains des secouristes, arrivés trop tard. C’est le chaos, le temps qui s’arrête pour Fatima lorsque les médecins viennent lui annoncer le décès de la fillette. « On m’a juste prévenu du décès de mon enfant sans me donner d’explication. Ils m’ont parlé d’une autopsie et j’étais d’accord. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s’est pas fait », assure-t-elle. Pour la mère de famille, le doute n’est pas permis : l’inhalation de gaz est à l’origine de la mort de son enfant. Fatima n’en veut cependant pas aux forces de l’ordre qui n’avaient, comme elle le considère, « pas d’autre choix ».
Du côté du dispensaire, la question de l’autopsie est rapidement expédiée. « Vous savez ici, c’est tellement courant qu’il n’y ait pas d’autopsie », justifie l’un des médecins. « Le bébé avait sans doute une bronchiolite et c’est vrai qu’un bébé qui a déjà du mal à respirer et qui inhale du gaz lacrymogène, cela peut causer ce genre de décès. Malheureusement, ce n’est qu’une victime collatérale de ces violences sans limites face auxquelles les forces de l’ordre n’ont rien d’autre que leurs gaz pour répliquer », poursuit l’homme de santé depuis le dispensaire d’où, vendredi, la voiture de la morgue emporte le bébé pour l’amener au village.
Un dernier voyage avant que le petit corps ne soit mis en terre, le plus prestement possible comme le veut la tradition. Depuis, Fatima est inconsolable. « Parfois je me réveille et je ne comprends pas pourquoi elle n’est pas à côté de moi. Je suis tellement seule. Il n’y a personne pour m’aider, pas-même son père qui ne l’a pas reconnue, et n’a jamais versé de pension », soupire-t-elle. Une tristesse qui s’ajoute à une précarité extrême. « Je n’ai rien et je dois tout faire pour les enfants. Nous ne mangeons que de la bouillie de riz. J’ai peur que mes enfants deviennent eux-aussi des délinquants », s’inquiète-t-elle. C’est le vide. La peur sans la colère, mais la vie sans espoir. La seule source de joie s’est tarie lorsque Mohamadi est partie. Laissant sa mère, seule, avec cette plainte lancinante qu’elle répète à voix basse :
« Elle s’appelait Mohamadi. »
Une enquête est ouverte
Mardi matin, la gendarmerie s’est rendue chez Fatima. Suite à son entretien avec les militaires, la mère de famille a décidé de porter plainte, non pas contre les forces de l’ordre qui ont tiré les grenades lacrymogènes, mais contre le dispensaire qui dépend du Centre hospitalier de Mamoudzou. Selon elle, le médecin puis les secours auraient mis plus d’une demi-heure à venir en aide au bébé en détresse respiratoire.
Dans la foulée, le procureur de la République a décidé d’ouvrir une enquête, ce qui empêche les hommes en bleu de s’exprimer sur le sujet. Le lieutenant-colonel Bisquert, de la gendarmerie nationale de Mayotte confie cependant que « les rues ici, ce n’est pas vraiment les Champs-Élysées, alors quand on tire des grenades dans la rue, les maisons sont forcément touchées, surtout si elles ont les fenêtres ouvertes. On ne peut pas éviter cela », assure-t-il, satisfait que la plainte de la maman ne soit pas dirigée vers ses services. Sur place, on retrouve encore de nombreuses cartouches vides même si un habitant explique que la très grande partie d’entre-elles a disparu parce que « les gamins jouent avec ».
 Soutenez
Soutenez