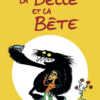« Il est désormais temps d’entrer en lutte, de combattre un défaitisme rampant et d’engager des démarches d’enseignement critiques et émancipatrices, soutenues par la robustesse de nos disciplines » écrit Servane Marzin, professeure d’histoire-géographie-EMC. Elle partage dans ce texte des réflexions qui ont parcouru une journée d’étude du SNES.
« Il est désormais temps d’entrer en lutte, de combattre un défaitisme rampant et d’engager des démarches d’enseignement critiques et émancipatrices, soutenues par la robustesse de nos disciplines » écrit Servane Marzin, professeure d’histoire-géographie-EMC. Elle partage dans ce texte des réflexions qui ont parcouru une journée d’étude du SNES.
Elle salue l’organisation de cette journée et la « circulation de la parole constitue le préalable incontournable à toute forme d’adaptation à ce contexte menaçant en même temps qu’elle est l’occasion d’exprimer une indispensable solidarité professionnelle et syndicale. Cette dernière s’avère déjà cruciale lorsque, localement, des collègues doivent composer avec des injonctions préoccupantes sur les contenus ou faire face à des menaces, sur l’EVARS par exemple ».
Ce lundi 10 mars, il n’y avait plus une place libre dans la grande salle de réunion au siège national du SNES : des enseignant·es d’histoire-géographie s’étaient déplacé·es très nombreux·ses pour la Journée de Réflexion Disciplinaire (JRD) consacrée à l’articulation entre recherche, enseignement et vulgarisation de l’histoire et de la géographie, organisée par le secteur Histoire-géographie de ce syndicat.
Et il ne surprendra personne que, dès le premier atelier d’échanges de la matinée et durant toute la journée, la crispation et l’augmentation des tensions dans l’espace public, national comme international, se sont imposées comme un enjeu central et brûlant. Les premiers invités ont d’emblée placé les interventions publiques des historien·nes et des géographes, comme enseignant·es et comme vulgarisateurices, dans un contexte marqué par l’accélération de dynamiques contraires, qui relève pour une large part de l’influence croissante de forces politiques à la fois ultralibérales et identitaires. Que cela se traduise par l’essor de l’usage des IA au détriment des faits, le rejet du savoir et des sciences sociales, les entraves à l’EVARS ou la dégradation programmée des services publics, l’actuel processus de transformation de l’espace public affecte directement et durablement nos missions comme notre éthique professionnelles.
« Finalités émancipatrices et profondément démocratiques de l’histoire et de la géographie »
Si le principe de ne pas renoncer aux finalités émancipatrices et profondément démocratiques de l’histoire et de la géographie ont fait consensus parmi les intervenant·es, des débats sont apparus sur les espaces dans lesquelles elles peuvent encore se construire et s’exprimer. Tandis que les un·es postulent que les devenirs sont encore ouverts et que l’histoire comme la géographie permettent de les mobiliser car elles reposent sur l’étude des possibles et des ruptures, les autres ont mis en avant un principe de réalité, actant la marginalisation de l’esprit critique dans l’espace public, mais aussi les verrous institutionnels -et notamment les programmes, empêchant de renverser un rapport de force actuellement défavorable.
L’après-midi, les témoignages et réflexion des intervenant·es, qui participent à la diffusion des savoirs sur différents supports -réseaux sociaux, vidéos, podcast, ouvrages de vulgarisation· ont confirmé les pressions qui s’exercent désormais sur celles et ceux qui conjuguent rigueur scientifique et large audience. Le harcèlement en ligne, les menaces personnelles, les dénonciations ne sont malheureusement plus rares.
« Des inquiétudes qui nous traversent toutes et tous »
Toutes et tous ont insisté sur l’importance de la solidarité entre actrices et acteurs travaillant à partir des faits et établissant des vérités -savants, collègues, journalistes d’investigation, militants et magistrats, et sur la nécessité de rendre visibles les démarches permettant de construire un discours vrai. A ce titre, les classes demeurent, il faut le mesurer, un des derniers espaces de savoir dans lesquels s’apprend la différence entre des faits et des opinions.
Ainsi, cette JRD a d’abord mis des mots sur les inquiétudes qui nous traversent toutes et tous. Ces partage d’expériences et de vécus professionnels jouent un rôle premier dans la prise de conscience de l’existence d’un rapport de force avec des acteurs qui ont un agenda politique clair, et le mettent en œuvre. Cette circulation de la parole constitue le préalable incontournable à toute forme d’adaptation à ce contexte menaçant en même temps qu’elle est l’occasion d’exprimer une indispensable solidarité professionnelle et syndicale. Cette dernière s’avère déjà cruciale lorsque, localement, des collègues doivent composer avec des injonctions préoccupantes sur les contenus ou faire face à des menaces, sur l’EVARS par exemple.
Les manières d’agir pour combattre les menaces qui pèsent sur la démocratie et ses valeurs
La JRD a enfin été l’occasion de réfléchir aux manières d’agir pour combattre les menaces qui pèsent sur la démocratie et ses valeurs. Plusieurs pistes ont été évoquées, transposables dans nos enseignements. En EMC, il est maintenant indispensable d’apprendre à nos élèves à prendre leurs distances avec la violence des réseaux sociaux, en ne nourrissant pas des joutes verbales destructrices et déséquilibrées, et de refuser de laisser prospérer les débats sur des faits, tels que le dérèglement climatique.
En histoire et en géographie, la mise en jeu des capacités d’agir des acteurs et actrices sociaux -dans l’espace comme dans le temps- , l’intérêt de travailler sur les césures et les ruptures pour déconstruire l’apparente continuité du roman national comme du récit territorial, la redéfinition des thématiques et des espaces étudiés en classe, en s’appuyant sur des objets scientifiquement stabilisés, quitte à « ruser » avec des programmes qui mobilisent parfois des contenus encore discutés dans le monde scientifique, constituent autant de sillons à creuser collectivement. Au fond, c’est l’esprit critique que nous devons construire et alimenter, à la fois comme fois soubassement fondamental de nos démarches scientifiques et comme outil majeur d’autodéfense intellectuelle, dans un contexte général de désinformation et de confusion.
Ainsi, cette JRD, arrivée à point nommé, a constitué un indispensable temps de respiration et de réflexion solidaires. Il faut souhaiter qu’elle ait également alimenté une prise de conscience : il est désormais temps d’entrer en lutte, de combattre un défaitisme rampant et d’engager des démarches d’enseignement critiques et émancipatrices, soutenues par la robustesse de nos disciplines.
Servane Marzin

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.