Au bord du terrain de basket, le survêtement et les cheveux bruns coupés courts de Mulkara Rahimi sont trempés de sueur. Malgré l’épuisement, elle se tient droite, souriante et fière sur son fauteuil roulant. Difficile de croire qu’elle existe dans un pays comme l’Afghanistan.
On la remarque dans le gymnase, elle est la seule à ne pas se couvrir les cheveux. « On a essayé de m’obliger à porter le voile, mais j’ai toujours dit non », dit-elle en riant. Une décision pourtant dangereuse en Afghanistan. L’astuce de Mulkara pour survivre à l’extérieur : se faire passer pour un garçon. Elle est plus à l’aise comme ça, les garçons la laissent tranquille et elle peut conduire sa voiture sans se faire déranger.
À deux ans, Mulkara s’est retrouvée paralysée à cause de la poliomyélite. Elle vivait alors dans une province reculée et le vaccin qu’elle a reçu n’a pas fonctionné. Pour elle, le basket-ball est aussi un remède. « J’étais déprimée avant de commencer », raconte-t-elle. « Maintenant je me sens vraiment forte. »
Nilofar Bayat, la capitaine de l’équipe, rejoint Mulkara. Ses grands yeux marrons soulignés au crayon noir pétillent. Sur le terrain, elle encourageait ses co-équipières et enchaînait les buts. « Je suis fière des filles », dit-elle. « Elles ont très bien joué aujourd’hui ». En effet, elles viennent de remporter la coupe du championnat national féminin de basket-ball en fauteuil roulant.
 ©Elise Blanchard
©Elise Blanchard
Le tournoi se déroule à la clinique orthopédique du CICR, à Kaboul, qui soigne les personnes handicapées et les blessés de guerre. En plus d’être dans l’équipe nationale et celle de Kaboul, Mulkara y travaille comme physiothérapeute depuis 10 ans. « J’apprends aux gens comment remarcher, » explique la jeune Afghane de 30 ans.
À 25 ans, Nilofar gère la base de données de la clinique. Elle y est aussi la patiente de Mulkara, car elle souffre d’un traumatisme de la moelle épinière depuis ses deux ans. En 1996, elle a été blessée lorsqu’un missile a frappé sa maison le jour où les talibans ont envahi Kaboul. Son grand frère n’a pas survécu.
C’était il y a 23 ans jour pour jour la veille de la coupe. « Chaque année, le 7 mars je me demande comment serait ma vie si ça n’était pas arrivé… mais hier j’étais tellement concentrée sur le tournoi que je ne m’en suis pas souvenu, » dit-elle d’une voix enjouée.
Les deux athlètes souffrent encore aujourd’hui. Elles remarchent, mais avec beaucoup de difficulté. Dans leurs bureaux six jours sur sept, elles portent une orthèse afin de mieux supporter les longues heures passées à voir défiler les patientes.
 ©Elise Blanchard - Mulkara soigne Nilofar à la clinique orthopédique
©Elise Blanchard - Mulkara soigne Nilofar à la clinique orthopédique
La plupart de ces patientes ne sont pas autorisées par leurs familles à voir des médecins hommes. Beaucoup ont dû venir de loin. Toutes ont ôté ou retroussé leurs tchadris en entrant dans la zone interdite aux hommes. Elles sont des dizaines, exténuées, à patienter à l’entrée du bureau de Nilofar.
Etre femme et handicapée en Afghanistan, c’est comme une double peine. « La plupart des familles cachent leurs filles handicapées, » déplore Nilofar. « Ils ne les laissent pas aller à l’école ».
Même à Kaboul, zone la plus développée et la moins conservatrice du pays, la quasi-totalité des lieux n’est pas accessible aux personnes handicapées. « Mes amies ne peuvent aller nulle part, » regrette-t-elle. Dans la rue, les gens rient.
Mais rien ni personne ne parvient à les décourager. Pendant plusieurs années elles cumulent leur emploi à la clinique la journée et les études le soir. Pour Mulkara c’est la fac de médecine, et pour Nilofar celle de droit. Cette dernière veut aider les femmes de son pays : « Dans les provinces, la plupart d’entre elles vivent comme des robots, » explique-t-elle. « Les hommes décident tout pour elles. Elles ne connaissent même pas leurs droits. »
Malgré leurs exploits sportifs, Mulkara et Nilofar, elles aussi, vont devoir continuer de lutter pour leurs droits. « Les gens ne sont toujours pas habitués à voir des femmes travailler et faire du sport, ils pensent que ce n’est pas bien, » dit Nilofar. Toutes deux redoutent d’être forcées à se marier et à abandonner basket et emploi. En effet, c’est ce qui est arrivé à nombre de leurs coéquipières.
« Si l’on me force à me marier, je partirai d’Afghanistan et laisserai tout derrière moi. J’aime trop ma liberté », s’exclame Mulkara. « Je me marierai peut-être à l’étranger si je trouve un partenaire ouvert d’esprit… mais jamais ici, » ajoute-t-elle.

©Elise Blanchard - Mulkara rentre chez elle en voiture à Kaboul.
Heureusement, son père, Gullamnabi Rahimi, la soutient dans ses choix. Qu’importe si elle est la seule parmi ses huit frères et sœurs à ne pas avoir d’enfants. Il est heureux de lui prêter sa voiture pour qu’elle la conduise pour se rendre à l’entraînement de basket le vendredi, son seul jour de repos.
« Je suis vraiment honoré quand je la vois travailler et aider ceux dans le besoin, ou faire du basket, » dit-il. Gullamnabi se moque de ceux qui le critiquent. « J’ai une réponse pour eux : chaque personne est libre de vivre comme elle l’entend. »
Mais Mulkara est inquiète : « Plus tard mes frères vont me forcer à me marier… » Sa gorge se sert. « Aujourd’hui mon père me soutient, mais quand il va nous quitter… »
Mulkara refuse de parler des talibans « Je les déteste, » se contente-t-elle d’affirmer. Et la paix ? Son visage s’assombrit et elle reste silencieuse. « Laisse tomber cette question. »
Elle préfère se concentrer sur son prochain tournoi de basket. Membre de l’équipe nationale avec Nilofar, elle doit se rendre en Thaïlande en novembre pour les qualifications des championnats d’Asie de 2020. Elle est impatiente, car cette année l’équipe n’a pas pu obtenir de visapour participer à la coupe de Bali, qu’elles avaient remportée en 2017.
Nilofar se souvient très bien de cette victoire. Enfin, surtout de la réaction des hommes de son entourage à son retour. « Beaucoup de ceux qui nous disaient que nous devrions être des femmes au foyer nous attendaient avec des fleurs pour nous féliciter. » Soudain, leur discours avait changé. « Tu es une fille forte, c’est bien, tu joues comme un homme, » disaient-ils. « Je leur répondais : “Non, jamais. Je veux être forte comme une femme,” »
Et des femmes fortes, il y en a beaucoup en Afghanistan, insiste Mulkara. « Le monde pense que l’Afghanistan est un mauvais pays, mais nous avons beaucoup de bonnes personnes ici, » dit-elle. « Les gens ne voient que les mauvaises choses… je veux qu’ils puissent voir les bonnes. »
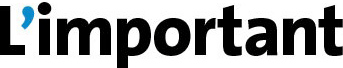







 ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER!
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER!



