Chaque jour, un ballet de bus déverse son flot de réfugiés à Horgos. Situé à quelques kilomètres de la Hongrie, l'ultime village serbe marque le point de départ de la traversée de la frontière serbo-hongroise.
En cette fin d’après-midi, le ciel est lourd et l'ambiance tendue. Débordée, une des vendeuses du petit supermarché s'improvise vigile et ne laisse entrer qu'un ou deux réfugiés à la fois. Un jeune Syrien soupire : «Pourquoi ne nous laissent-ils pas entrer à plusieurs ? Nous ne sommes pas des voleurs ! Je veux seulement acheter un peu d'eau pour la route. Regardez, j'ai de l'argent sur moi, je peux payer !»
Plus loin, des dizaines de réfugiés, pour la plupart des familles, s'immobilisent près de la route menant en Hongrie. Personne ne semble vraiment savoir quand commencer à avancer. Des regards perdus se croisent, tous attendent impatiemment que quelqu'unfranchisse le pas. Ahmed et ses trois amis donnent le signal de départ en s’élançant les premiers sur la route. Les réfugiés ramassent rapidement leurs affaires avant de se ruer derrière eux.
La plupart des réfugiés que nous accompagnons viennent de Syrie. Après avoir traversé les Balkans, ils tentent désormais d'entrer illégalement en Hongrie dans le but de rejoindre le plus vite possible l'Europe du nord pour y présenter leurs demandes d'asile. Ceux qui se feront arrêter sur le sol hongrois seront fichés avant d'être conduits dans des camps. Tous savent qu'une règle de l'Union Européenne oblige les réfugiés à déposer leur demande d'asile dans le premier pays où ils arrivent. L'objectif est donc de ne pas se faire arrêter jusqu'à l'arrivée dans le pays désiré.
Alors que les policiers serbes les encouragent à avancer en pointant du doigt la direction de la Hongrie, les réfugiés sont brutalement stoppés par deux douaniers armés de matraques. Un 4x4 de la douane serbe bloque la chaussée. Les deux hommes en uniforme repoussent violemment ceux qui tentent de franchir le barrage. Très vite, une cinquantaine de personnes se pressent devant la voiture. Le ton monte. Nul ne passera à moins de débourser 25 euros par personne. Ensemble, les réfugiés font face. Submergés par le nombre, les deux hommes finissent par laisser passer le groupe.Nous quittons tous rapidement la route principale, préférant emprunter un chemin plus discret loin des postes-frontières.

A la tombée de la nuit, nous marchons déjà depuis une heure le long de la voie ferrée menant en Hongrie. Les réfugiés formentdésormais un groupe d'une centaine de personnes. Une jeune Syrienne et son fils marchent en son centre, c'est là qu'ils se sentent le plus en sécurité. «Marcher tous ensemble nous donne du courage. Je me sens protégée. Rester groupés nous donne de la force.»Les chefs de file nous font signe de nous arrêter. Nous devons quitter le chemin de fer pour un champ de maïs. Nous nous immobilisons en silence à l'orée du champ. Un autre groupe d'une cinquantaine de personnes le traverse déjà. Pour ne pas attirer l'attention, nous attendrons notre tour. Epuisé, un vieil homme au visage émacié s'assoit au milieu du champ. Il fume discrètement une cigarette dont il prend soin de cacher la braise.
Soudain, une voiture se dirige dans notre direction et crée un mouvement de panique. Le groupe éclate, les réfugiés se dispersent et disparaissent à l’abri du maïs. Tout va bien, la voiture fait demi-tour. Le groupe se reforme. Par prudence, nous préférons regagner la voie ferrée.
A travers la route des Balkans, les dangers sont nombreux pour les réfugiés. En situation illégale, ils sont des proies faciles. Un grand nombre d'entre-eux nous ont rapporté des cas de vols, d'agressions ou encore de corruptions. Des passeurs et des chauffeurs de taxis sans scrupules n'hésitent pas à profiter de la situation, allant jusqu'à leur demander des sommes exorbitantes pour les aider à rejoindre l'Europe de l’ouest le plus rapidement possible. Sur le chemin menant en Hongrie, des éclaireurs improvisés assurent la sécurité des groupes.
Dans l'obscurité totale, les traverses en bois du rail sont notre seul point de repère. La tension est palpable. Des bruits de pas résonnent au loin. Le groupe se resserre en silence et tremble à l'unisson.Trois hommes avancent de quelques mètres, scrutent l'horizon avant de nous faire signe d'avancer. Pas de danger en vue. Nous regagnons de nouveau les champs. A travers les hautes herbes, Brahim rejoint notre groupe. Essoufflé, il porte depuis des heures sa fille de trois ans à bout de bras. Bercée par les pas de son père, elle a fini par s'endormir. Il pose son regard sur nos appareils photo. «Il faut que les gens sachent ce que l'on vit ! C'est très difficile surtout pour les enfants.» Il passe délicatement sa main sur les cheveux de sa fille. «Elle devrait être endormie dans un lit, pas dans un champ.» Son regard se durcit soudainement. «Je suis très en colère, des policiers serbes m'ont obligé à payer le passage. Des dizaines de personnes ont dû leur donner l'argent pour pouvoir continuer d'avancer. Cette corruption est inacceptable.»
Des cris retentissent. A environ 200 mètres, des faisceaux de lampes-torches balayent vivement les herbes. Nous approchons de la frontière, et un groupe de réfugiés est en train de se faire arrêter par les policiers hongrois.
Dès août 2015, afin de contenir le flux de réfugiés hors de son territoire, le gouvernement hongrois achevait la construction d’une clôture de barbelés de 175 kilomètres de long et de 4 mètres de haut à la frontière avec la Serbie. De nombreux policiers patrouillent à pied et en voiture aux abords du mur.
Le flot des voitures roulant à grande vitesse sur une route située à quelques mètres, nous ramène brutalement à la civilisation. Sur le chemin de terre escarpé menant à son entrée, nous croisons un groupe blotti dans le maïs. Tous sont regroupés autour d'une vieille femme entièrement drapée de blanc. «Tout le monde sait pourquoi nous fuyons la Syrie. A cause de la guerre! Nous voulons aller en Allemagne ou en Suède. Là-bas, nous pourrons vivre en paix. Je ne veux pas aller dans un camp. Je veux passer les derniers jours de ma vie dans un endroit où je me sens heureuse et libre, que cela soit en Europe ou chez moi.» soupire-t-elle dans un anglais parfait.
Alors qu'un vent violent commence à se lever, un fourgon de police se dirige vers nous. Une nouvelle fois, les réfugiés se dispersent.
Cachés dans les épis, nous sommes une dizaine le souffle coupé. Le camion s'arrête à moins de 10 mètres de nous. Tandis que le moteur ronronne, l’immense projecteur posé sur son toit scrute l'horizon. Une mère retient son enfant contre elle. Un seul bruit et ils devront passer entre 3 et 8 mois dans un camp hongrois dans de des conditions de vie les plus précaires. Tous le savent.
Quelques instants plus tard, la patrouille rebrousse chemin. Une pluie battante se met aussitôt à s'abattre sur les corps épuisés. Derrière nous, sur le sol boueux, seuls des dizaines de sacs abandonnés dans la panique témoignent de notre passage.
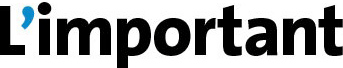







 ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER!
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER!



